-
Peut-être maintenant une hâte de regagner l’année zéro, de laisser s’éclipser une humanité déjà étrangère qui poursuit son chemin, être absorbé par les paupières de la forêt, il est temps de rentrer dans ce monde et dans ce poème qui durent – c’est simple et lumineux.
J’avais douze ans quand ma ville natale Amiens a été détruite ; j’ai passé mon adolescence dans les décombres – c’étaient des décombres clairs et innocents ; plus tard il y eut de nombreuses ruines moins innocentes, celles de la civilisation campagnarde qui avait été celle de l’Europe, celle des idéologies... j’ai aussi vécu dans ces ruines, d’une humanité nouvelle – je tiens de toutes mes racines aux décombres. Je peux dire que ch’catieu de Picquigny et le picard sont des décombres auxquels je me cramponne.
La poésie elle-même aujourd’hui semble passée. Obsolète et muchée comme le picard le château de Picquigny derrière les siècles, derrière ce siècle. Alors les clandestins se rencontrent et s’attachent l’un à l’autre.
La poésie se fait picarde et catieu d’Pinkigni (1277).
La langue poétique a aussi des créneaux et des meurtrières ; elle est elle-même un château fort ; regardons un sonnet sur sa page ! Eine feste Burg ist unser Gedicht (*).
Le château de Picquigny, c’était mon lieu de jeu préféré quand j’étais enfant ; nous venions d’Amiens à vélo ou à pieds, ou nous prenions le train à la gare Saint-Roch ; nous montions au château le sac plein d’illustrés, Tarzan, Mickey ou Bibi Fricotin – et quand nous redescendions nous allions manger de la tarte aux pruneaux chez Madame Weiss près de la gare ; plus tard, adolescent, je revins acheter des pigeons boulants qu’un éleveur expérimenté, installé près du passage à niveau, me vendait ; j’avais la passion des pigeons, je l’ai encore ; un autre éleveur qui habitait Saint-Pierre-à-Gouy me vendait de magnifiques Cauchois. Je collectionnais alors des livres sur l’élevage, aussi vieux – enfin, presque – que le château de Picquigny. J’avais, j’ai encore, un livre du XVIIIe siècle sur l’élevage des oiseaux ; je me souviens l’avoir lu dans la cour en contre-bas du donjon ; je me souviens des chauves-souris dans les souterrains du château – et dans un couloir cet extraordinaire gibet avec une haute échelle et des mots inscrits dans la craie – déjà une poésie visuelle.(*) « Une forteresse est notre poème » –
d’après le célèbre vers de Luther « Eine feste Burg ist unser Gott » – « Une forteresse est notre Dieu ».Pierre Garnier
Extrait de :

PICARDIE
Pierre Garnier
Format 20 x 29.5 cm - 200 pagesPour en savoir plus sur ce livre...
Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Entre Dives et Ouistreham...
A une petite distance de Home-Varaville, et faisant partie de la commune de Merville, on trouve une vieille redoute, un fort, dont les gardiens devaient autrefois surveiller une assez vaste étendue de côte et particulièrement l’entrée du fleuve l’Orne.
Par malheur, on négligeait souvent de renouveler ces garnisons, et le moment vint où la redoute de Merville ne compta plus qu’un seul défenseur.
Mais, dans le cœur de cet unique soldat, un grand courage s’alliait à l’amour de la Patrie : il en devait donner une preuve merveilleuse.
C’était en 1762. Nous nous trouvions en guerre avec l’Angleterre et, chaque jour, des tentatives nouvelles avaient lieu contre nos ports. Un après-midi, Michel Cabieu, ainsi se nommait le gardien de la redoute, s’aperçoit que des navires ennemis se dirigent vers l’embouchure de l’Orne, avec l’intention évidente d’y préparer un débarquement de troupes.
Une anxiété généreuse étreint l’âme de Cabieu. Que peut-il faire ? Périr ou être emmené prisonnier... sans que sa propre perte soit utile à la Patrie. Le brave soldat ne se résigne pas à une telle alternative. L’esprit, le sang-froid, unis au courage, lui inspirent un plan bien simple.
Il sait que la redoute est à demi-cachée par les dunes de sable. Facilement, il épie toutes les manœuvres de l’ennemi, sans que ce dernier soit à même de se rendre compte du plus ou moins de force de la garnison française.
Cabieu profite de cette situation. S’emparant d’un tambour, il se hâte de battre une charge furieuse, en même temps qu’il crie, parle, donne des ordres à des soldats imaginaires, fait rouler des cailloux le long des murailles. Le tout sans relâche et avec un entrain extraordinaire.
Les Anglais s’étonnent... Auraient-ils été mal renseignés ? Leur entreprise, si bien combinée, va-t-elle trouver un obstacle sérieux ? Le tapage redoublant, la prudence l’emporte, les voiles sont déployées elles navires s’éloignent lentement...
Cabieu n’ose encore croire à son triomphe. Il continue à faire tout le bruit possible ; mais quand, enfin, vaincu par la fatigue, il tombe épuisé, son regard suit avec joie, dans l’ombre du soir, la silhouette, de moins en moins distincte, des bâtiments ennemis.
Au matin, l’air frais le ranime, mais nul danger ne menace plus ce point du pays : la mer est libre...
Les habitants firent une ovation à Michel qui, désormais, fut connu sous la caractéristique appellation de : Général Cabieu.
Gaiement, il la porta jusqu’en 1804, époque de sa mort.
Elle était bien méritée... A soi, tout seul, disperser une flotte !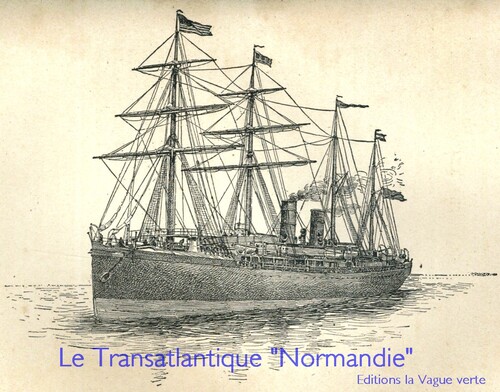
Les annales de nos provinces sont pleines de ces traits généreux que l’indifférence oublie, mais qu’il est bon de présenter parfois à notre souvenir, pour raviver en nous la grande image de la Patrie.
Les circonstances du beau fait d’armes de Cabieu se trouvent diversement relatées dans plusieurs documents authentiques ; mais tous sont unanimes à louanger l’humble garde-côte.
Un Mémoire tiré du recueil de M. C. Hippeau, ancien professeur à la Faculté de Caen, Mémoire faisant partie des archives du château d’Harcourt, dit que... « Cabieu, sergent garde-côte de la paroisse d’Ouistreham, se mit à la tête de trois ou quatre gardes-côtes qu’il rencontra et marcha vers les Anglais : ses compagnons l’abandonnèrent. »
Une autre pièce est le récit fait à l’Assemblée constituante, le 4 septembre 1790, par M. Cussy, député du Calvados ; il contient ce passage significatif « le seul tambour de sa compagnie l’avait suivi, mais ne tarda pas à le quitter... »
Un rapport rédigé par Oudot et lu à la Convention nationale, le 25 thermidor an II (12 août 1794), dit expressément :
« Michel Cabieu se porte au-devant de l’ennemi... »
La seule différence dont nous devions tenir compte, c’est que la redoute défendue est celle d’Ouistreham, toutes les relations s’accordant à la placer sur la rive gauche de l’Orne, tandis que la station de Merville est située sur la rive droite.
Quoi qu’il en soit, le numéro du Moniteur universel, portant la date du 15 août 1794, contient un décret de la Convention donnant à Ouistreham le nom de Cabieu.
C’était dignement honorer le courageux soldat.
Pendant quelques années, le décret fut respecté et l’on trouve, toujours dans le Moniteur, le récit de plusieurs faits accomplis à Cabieu ; une parenthèse sépare le nom nouveau du nom ancien, qui finit cependant par reprendre droit de cité.
Louis XV avait accordé à Cabieu une pension de cent livres. Le 4 septembre 1790 et le 12 août 1794, il fut de nouveau recommandé aux députés.
La Convention lui vota un secours de six cents livres, et nous venons de voir ce qu’elle fit pour sa réputation.
Né le 2 mars 1730, le général Michel Cabieu mourut le 4 décembre 1804.Extrait d'un livre à paraître en mai :
Le littoral, côtes picardes et normandes, de Dunkerque au Mont Saint-Michel
par V. Vattier d'Ambroye
Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire
-

Les œufs, beurre, fromages se vendent au Béguinage, devant le couvent des Sœurs de Saint-François (ancienne place Lefébure de Cerisy ou Placette). Les chapons, pigeons, oies, poules, canards et autres volailles se vendront au Grand Marché, depuis l’enseigne du Bar (côté Est de la place) jusqu’à la veille maison Sueur. Les fruitiers étalent et vendent tous les jours de la semaine devant l’église Saint-Vulfran depuis le chemin des Halles jusqu’à la maison Barbafust. Les tartes, pâtés, norolles (espèce de petite brioche) venant du dehors, se vendent au Grand Marché autour de la croix, assez loin des étaux des boulangers de la ville. Les poireaux, ail, oignons, etc. se vendent depuis la porte de derrière de l’Hôtel-Dieu, le long de la muraille, jusqu’à l’huis du cimetière Saint-Vulfran. Les revendeurs d’œufs, beurre, fromages et volailles ne peuvent acheter ces denrées aux paysans avant 10 heures, ni avant qu’ils les aient exposées en vente à peine de 60 sols d’amende, dont le tiers à l’accusateur. Les blattiers et meuniers ne peuvent acheter des blés avant midi, sous peine de punition corporelle, 60 sols d’amende et confiscation desdits blés. En 1602, le marché au beurre fut transféré devant Saint-Vulfran, pour dégager la porte de l’Hostel-Dieu, tandis que l’échevinage transfère le marché aux chevaux de la Porte Saint-Gilles à la place Saint-Pierre où sont les hôtelleries et donc plus commode. Celle-ci accueillera un demi-siècle plus tard le marché aux chanvres et aux lins tenus tous les jours de franc-marché et tous les jeudis en la rue des Jeux de Paume et de l’Arquet. Tout le centre de la ville paraît avoir été envahi par les grands marchés, en particulier, les abords du Marché au blé et du pont aux Brouettes. On imagine les encombrements dans ce dédale de rues et de ruelles bien qu’il fût enjoint aux marchands de faire leur étalage de manière que les habitants fussent point gênés pour circuler.
Source : Micheline Agache, extraits, (avec l’autorisation de R. Agache).
Extrait de :
 LES " FICELLES " DE LA CUISINE PICARDE
LES " FICELLES " DE LA CUISINE PICARDEHISTOIRES ET RECETTES
Michel François
15.5 x 22 cm - 160 pages avec illustrationsPour en savoir plus sur ce livre...
Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le château de Pierrefonds a été reconstruit par Louis d’Orléans à la fin du XIVe siècle. Il fut ensuite démantelé, puis restauré par Viollet-Le-Duc, grâce à Napoléon III.
La pierre employée pour la construction du château de Pierrefonds provient de la carrière de Retheuil située à 3,5 kilomètres au Sud-Est de cet édifice. Des pierres ont été également extraites de carrières proches du champ Dolent, qui se trouvaient à 1,5 kilomètres du château.
Sur les parements des pierres constituant notamment les murs de la face Ouest, (le parement, répétons-le, est leur surface visible) il faut noter la présence d’un grand nombre de marques de tâcherons.
Les tailleurs de pierre étant à cette époque payés à la tâche, marquaient d’un signe, gravé sur le parement de chacune des pierres qu’ils venaient de tailler.
Ce signe pouvait être une croix, un cœur, une étoile, le dessin d’un outil, etc. On trouve également un grand nombre de marques de tâcherons sur les parements du château de Coucy, ou encore sur celui de Vincennes. Concernant ces marques gravées il faut signaler une particularité qui vaut notamment pour les châteaux de Pierrefonds et de Vincennes: en effet ces pierres contiennent deux marques : Comme nous venons de l’indiquer l’une sert à identifier l’ouvrier qui l’a taillée, tandis que l’autre indique l’origine de la pierre, (à Pierrefonds ce signe est constitué de 3 ou 4 traits parallèles, presque verticaux) car à Pierrefonds, comme à Vincennes,
plusieurs carrières ont été exploitées simultanément pour la construction de ces châteaux.
Entre les XIIIe et XIVe siècles, pour tailler les pierres destinées à la construction des édifices religieux, on se sert le plus souvent de la bretture (du moins dans les régions du domaine royal, à l’exception de celles qui ne possèdent que des pierres dures ou très dures) afin d’obtenir une taille de finition affinée.
La bretture est un outil en acier qui comporte deux tranchants droits (comportant chacun des dents plates), parallèles au manche qui est en bois, et dont la forme générale fait penser à celle d’une double hache dont chacun des deux tranchants serait non pas arrondi, mais droit.
Par contre, sur beaucoup d’édifices militaires de cette époque, on peut voir des parements bossagés (c’est-à-dire que le parement de la pierre, donc sa surface visible, offre une protubérance irrégulière par rapport à ses bords, lesquels comportent une ciselure périmétrique) ou des parements dressés assez grossièrement, parce que la taille n’avait pas besoin d’être aussi affinée que pour les édifices religieux, mais aussi afin de pouvoir élever ces constructions dans le minimum de temps.
Au château de Pierrefonds, par contre, le parement des pierres est très lisse : il semblerait qu’il ait été exécuté au ciseau qui permet une taille très précise proche d’un lissage (contrairement à la bretture qui laisse des stries sur la pierre). Comme l’a indiqué Jacques Harmand, les parements présentent un aspect étonnamment lisse qui confère à l’édifice une valeur esthétique (voir page 43, “Pierrefonds - La forteresse de Louis d’Orléans - Les réalités”, édité en 1983).
Cependant, considérer que cette taille qui donne à la pierre un aspect lisse est très esthétique, ne reflète pas l’opinion des médiévistes.
En effet, comme l’a souligné Viollet-Le-Duc, à la fin de l’article “taille” du Dictionnaire Raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, le fait de tailler des parements extrêmement lisses « amollit les tailles, leur enlève cette pellicule grenue et chaude qui accroche si heureusement les rayons du soleil. Les moulures, les tapisseries, prennent un aspect uniforme, froid, mou, qui donne à un édifice de pierre, l’apparence d’une construction couverte d’un enduit. »
Extrait de :

LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE PIERREFONDS
Jean-Marc Laurent
14 x 21 cm - 128 pages - Illustrations
Pour en savoir plus sur ce livre...
Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Traditionnellement, la vache de race flamande formait le gros des troupeaux. Petite, vive, de robe noire, aux longues cornes, bonne marcheuse, résistante, elle donnait « bien du lait » et facilement de beaux veaux. Les vaches hollandaises les ont chassées des étables. Ces animaux énormes, poussifs, aux gros pis gonflés et déformés, aux pieds faibles, à la santé fragile, avaient un seul avantage, ils produisaient beaucoup de lait. Des croisements entre les deux races donnèrent des animaux mieux proportionnés avec une bonne lactation mais la venue des veaux, trop gros, causait des soucis.

La campagne d'Artois (1945-1965)
L’élevage de ces animaux fragiles n’était pas facile. Les vaches attrapaient des mammites (inflammations des trayons) ou elles prenaient froid. Souvent le vétérinaire devait venir. C’était une personnalité reçue avec respect, écoutée sans discuter et qui voyageait avec sa provision de médicaments. On ne se privait quand même pas de supputer qu’il devait être très riche au prix de ses consultations. Le vétérinaire devait encore venir quand une vache s’étranglait avec un bout de betterave trop gros qui ne passait pas. L’homme de l’art repoussait ce corps étranger dans l’estomac avec un long écouvillon flexible. Les vaches vêlaient une fois par an. Quand le moment approchait, l’animal était surveillé et ramené des pâtures à la ferme. La dilatation commençait et le spécialiste de la ferme, il y en avait toujours un, en général un homme, plongeait son avant bras dans l’utérus de la vache pour vérifier que la tête du veau se présentait bien, pour placer ses pattes en long, pour mesurer le travail qui restait à faire et annoncer le sexe de l’animal. Une fois le veau engagé, on attachait ses pattes à deux cordes non tressées pour ne pas blesser la mère. Aux deux autres extrémités, elles étaient attachées à de courts bâtons, les assistants tiraient au rythme des contractions pendant que « l’accoucheur » continuait à guider le veau dans le ventre de sa mère; enfin tout allait soudainement très vite et le petit, tâché de sang, luisant de mucus, glissait sur la paille, déjà prêt à se lever. Une génisse était toujours appréciée mais un petit mâle permettait un gain plus rapide puisqu’on pouvait le vendre gras au bout de quelques mois. Le petit était bouchonné, nourri au pis de sa mère, tandis que l’on attendait la délivrance. Les vaches qui avaient eu du mal à vêler restaient allongées par terre, à bout de forces ; une bouteille de vin blanc additionné de sucre, versée dans leur gorge, les rétablissait. Personne ne regrettait la bonne bouteille tirée de la cave familiale. Si en général les vêlages se passaient bien, quelquefois il fallait encore faire appel au vétérinaire pour découper le veau mort-né dans le ventre de sa mère.Extrait de :
 ABÉCÉDAIRE DU MONDE PAYSAN
ABÉCÉDAIRE DU MONDE PAYSAN
La campagne d’Artois vers 1950
Dominique Voisin14 x 21 cm - 148 pages avec cahier-photos N/B
Pour en savoir plus sur ce livre...
Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire




