-
Dès le XVIIe siècle, alors que les gazettes naissantes n’étaient encore que de sèches chroniques hebdomadaires, c’est par les nouvellistes que les informations circulaient sous le manteau.
Dans un coin de jardin public ou autour du poêle de quelque café, quelle joie pour ces infatigables oisifs de deviser des échos de la cour et de la ville, de décider en paroles des affaires du royaume.Les journaux qui ont paru dans le département de la Somme au cours de cette période sont au nombre de quatre :
1°) « Annonces, affiches et avis divers de Picardie (etc) ».
Numéros conservés : de janvier 1770 à l’an XI.
2°) « Le courrier du département de la Somme » à partir de juillet 1790.
3°) « Le journal général de la République française », à partir de mars 1793.
4°) « La Décade », à partir du 9 pluviôse an VI (28 janvier 1798).Deux de ces journaux donnent, sans commentaires, des informations sur les événements politiques : Le Courrier du Département de la Somme et Le journal général de la République française.
Les Annonces, affiches de Picardie, sont par contre, un journal d’annonces diverses.
Le journal de la République, et La Décade, donnent uniquement les nouvelles officielles (comme Le Moniteur qui paraissait à Paris), et cela sans prise de position purement politique.
Le département ne paraît pas avoir, pendant la Révolution, de presse vraiment engagée. Seul Le Courrier du Département prend position sur les événements, mais pendant une courte période, de juillet 1790 jusque 1791. Ainsi, dans les années ardentes de 1793 et l’an II, Le département ne paraît pas avoir eu de presse libre ou partisane, ni de journaux de combat. Il faut remarquer que si les hommes politiques d’Amiens, dAbbeville et des autres villes de la Somme furent d’abord favorables à la Révolution, ils restèrent modérés. A partir de 1793, évident fut l’ascendant d’André Dumont, le fougueux député montagnard. Or celui-ci ne se sert pas de la presse pour se faire connaître ou obéir. Il devient populaire dès son élection à la Convention en septembre 1792.
Il manifeste son autorité au cours de ses multiples périples dans le département de la Somme et dans le Boulonnais.
Une presse qui ne donnait que des annonces officielles suffisait sans doute aux citoyens de la Somme. De ce fait, les pouvoirs locaux comme les citoyens eux-mêmes ont suivi, sans trop de conflits, les directives du pouvoir central, les ordres de Dumont.
1°) Le plus important de ces journaux paraît dès 1770, sous le titre :
« Annonces, Affiches et Avis divers de Picardie, Artois, Soissonnais et Pays-Bas français. »
En 1778, on retranche les Pays-Bas français et d’Artois. Le titre devient alors : « Affiches, Annonces et Avis divers de Picardie et du Soissonnais ».
En 1790, le titre devient : « Affiches du département de la Somme ». Il est édité chez Godard, libraire à Amiens, d’abord rue des Rabuissons, puis rue Saint-Méry. Après lui, en août 1777, l’imprimeur-éditeur sera Jean-Baptiste Canon l’aîné, place du Périgord à Amiens.
Il paraît tous les samedis, en une feuille grand in-4°. A partir du 6 janvier 1770, le prix s’élève à 7 l. 10 s. par an. En 1792, il atteint 9 livres. Le dernier numéro est daté du 9 floréal an IX (29 avril 1801). A partir du 1er nivôse an II, il ne paraît plus que les 10, 20, 30 de chaque mois, jours de Décade.
C’est en premier lieu un journal d’annonces, avec en plus des articles divers sur l’agriculture, le commerce, les arts, la littérature, la jurisprudence, la médecine, l’hygiène, des recettes, des nouvelles de la province, les arrêts du Conseil d’état du Roi, les décès, les mariages, l’entrée des navires dans les ports de Dunkerque et de St-Valery, le prix des grains, les livres nouvellement parus. En 1792, la première page donne toujours les biens à vendre ou à louer, les divers objets à vendre, les demandes d’emploi. On trouve dans les pages suivantes les prix des gains, les observations météorologiques, les incendies, les cérémonies à Amiens, les spectacles, les adresses au Roi, les livres nouveaux parus chez Caron l’aîné, et aussi des poésies, des logogryphes, des fables, des bouts-rimés, des charades, des extraits du Registre aux délibérations de la municipalité d’Amiens et du Conseil du Département.
Le n° 44 des Affiches du département de la Somme (3 novembre 1792) publie un article signé Babeuf : « Aux acteurs du théâtre d’Amiens », article reproduit par Maurice Dommanget dans son livre : « Pages choisies de Babeuf ». Celui-ci était déjà connu dans le Santerre et l’Amiénois, et il est intéressant de souligner cet article, dans un journal qui donnait peu d’avis politiques en général.
Jacques Foucart a signalé un autre article de Babeuf paru dans le n° du 16 juillet 1791 des « Affiches ».
Le 5 octobre 1793, le journal publie in extenso la loi sur le Maximum des prix, loi qui vient d’être votée. Tous les tableaux de taxation des prix sont donnés à la suite.

On se réunissait pour apprendre les nouvelles soit en lisant les gazettes soit en prêtant l’oreille
aux propos des colporteurs.
2°) « Le Courrier du département de la Somme ».
Il paraît à Amiens en 1790/1791 in 8 :
Le rédacteur était J.-C. Duméril, avec Caron-Berquier comme imprimeur. Ce journal donne des articles d’information et de politique.
Des numéros sont conservés à la Bibliothèque Nationale et à la Bibliothèque de l’Arsenal à Paris. La Bibliothèque d’Amiens n’en possède pas. Les Archives départementales de la Somme non plus.
3°) « Journal général de la République française ».
Ce journal est publié à Amiens de mars à juillet 1789 (19 n°). Il paraît chaque samedi (8 pp. in 4°). Le rédacteur-imprimeur est Caron-Berquier, rue Saint-Martin à Amiens. Son prix est de 7 l. 10 s. par an
Ce journal comporte les nouvelles officielles, le compte-rendu des séances de la Convention, quelques nouvelles du département : tribunaux, armées, nouvelles de l’étranger parfois. Il n’y a aucune annonce ni avis divers, sauf celui des livres en vente chez Caron-Berquier.
4°) « La Décade du département de la Somme ».
Paraît à Amiens tous les dix jours, du 29 pluviôse an VI (17 février 1798) au 30 nivôse an VIII (20 janvier 1800) (en deux séries). Ce journal comporte 4 pp in 4°. Certains numéros comportent 6 pages.
Le rédacteur est Demanche à partir du 19 brmaire an VIII (10 novembre 1799) et l’imprimeur Patin et Cie, rue des Sergents.
C’est un journal d’information commerciale et littéraire comprenant diverses rubriques : législation dans chaque numéro, plusieurs pages avec un extrait du Bulletin des lois ; Tribunal criminel du département de la Somme ; Administration ; Biens nationaux ; Commerce ; Bourse ; Cours des changes, des lingots d’or, les lingots d’argent; Cours de l’épicerie ; Avis, annonce ; demandes des particuliers ; Contrats d’immeubles ; Littérature ; Vers du citoyen Lecat d’Abbeville ; Nombreuses poésies conventionnelles, imitées de Martial, par Loisel de Rue, administrateur du département de la Somme. On lit dans le n° de frimaire an VII : Compte-rendu, rien sur les événements, ni sur la politique.
Ce journal devient en 1802 le Bulletin de la Somme.
Robert Legrand (reproduction autorisée par l’auteur).Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Au large de Cayeux-sur-Mer...
Dans l’histoire, les ports de Saint-Valery et du Crotoy furent relativement peu touchés par des tempêtes maritimes, parce que protégés par les contours de la baie et par ses bancs de sable. De même que le port du Hourdel pourtant à la Pointe du même nom mais abrité derrière son poulier (bancs de sable et de galets) et à l’intérieur d’un chenal.
Par contre, Cayeux-sur-Mer qui n’est qu’à 4 km du Hourdel, situé sur une côte rectiligne face au grand large, à très faible altitude au-dessus du niveau de la mer, les a toujours subies de plein fouet.
Dans son ouvrage « Histoire des 5 villes, 300 villages, hameaux et fermes » paru en 1863, l’écrivain abbevillois E. Prarond a relaté ces drames cayolais du XIXe siècle. Il y rapporte l’article du Journal d’Abbeville en date du 5 octobre 1833 et signé du nom de L’explorateur picard, tout en précisant qu’il pèche par quelque arrangement systématique. Il témoigne néanmoins de la férocité de la mer en cet endroit, ainsi que des mœurs locales à cette époque. Le voici donc, avec la traduction en français des passages en patois picard :
« ... nous entrâmes dans le bourg de Cayeux dont les maisons, rassemblées sans ordre et alignement, semblent avoir été éparpillées à plaisir par un ingénieur capricieux et baroque. Une partie de la population était en deuil ; la mer quelques jours auparavant s’était soulevée, furieuse, impitoyable ; elle avait englouti dans ses ondes salées, grand nombre de ses explorateurs intrépides, hommes amphibies, familiarisés avec ses dangers et qui, bravant son inconstance, s’éloignent du foyer conjugal pour rapporter, des climats lointains, les productions que la mer n’a pas accordées aux nôtres, ou procurer à nos gourmets les mille espèces de poissons qui doivent flatter plus ou moins leurs palais délicats. Quelques-unes de ces malheureuses victimes étaient de Cayeux ; elles laissaient des veuves et des enfants dans la désolation. Pendant neuf jours, on avait vu des familles entières errer sur la plage humide pour redemander aux vagues les cadavres de leurs proches. La mère avait retrouvé son fils, l’épouse son mari. On les avait rapportés à Cayeux et le jour de mon arrivée était celui de leurs funérailles. La cloche de l’église paroissiale ébranlée par des bras salariés retentissait depuis plusieurs jours et portait aux oreilles des paisibles Cayolais des sons tristes et lugubres : c’était le glas funèbre, le signal de la mort. La cloche semblait partager la douleur générale et ne résonnait plus les chants d’allégresse qu’elle exprimait naguère pour un mariage.
Les convois avançaient lentement, précédés de la croix argentée et des chantres en surplis, dont les voix sépulcrales psalmodiaient des chants funéraires. Au milieu d’une foule de peuple on remarquait à leurs habits de deuil, à leurs énergiques lamentations, les parents des défunts.Une épouse s’exprimait ainsi :
— Pauvre Jacques, t’as donc pu r’nir pour foere boulir ten pichon à l’caudière ! (...tu n’as donc pu revenir pour faire bouillir ton poisson à la chaudière !)
— Eh ! Qu’est-che qui mettro l’bieu capé que j’tai acaté à l’trotrie ? (Qui est-ce qui mettra le beau chapeau que je t’ai acheté à la trotterie ? – foire annuelle de St Valery)
— Qu’est-che qui buvro l’chopène dieu-d’-vie de l’s’mène ? (Qui est-ce qui boira la chopine d’eau-de-vie de la semaine ?)— Qu’est-che qui coucro aveu mi à c’t’heure ? (Qui est-ce qui couchera avec moi maintenant ?)
— Qu’est-che qui m’caressro ? (Qui est-ce qui me caressera ?)
— Tu disoes d’acater un baté neu ; tu n’savoues point qu’i t’in auroe fallu in où tu n’peux t’nir qu’ti tout seul ? (Tu envisageais d’acheter un bateau neuf ; tu ne savais pas qu’il t’en aurait fallu un où tu ne pouvais tenir que toi seul ?)
— Ah ! pauvre Lazerre, pourquoi n’t’es-tu point méfiai du coup d’vint d’aval ? (Pauvre Lazare, pourquoi ne t’es-tu pas méfié du vent d’aval ?)
D’un autre côté, une jeune fille chantait ainsi sa douleur :
— Min por quiot Pierr ! o devoêmes nous marier mardi qui vient ; t’vlo marié avec ches pichons. (Mon pauvre petit Pierre ! nous devions nous marier mardi prochain ; te voilà marié avec les poissons)
— Qu’est-che qui m’consolro ? Qu’est-che qui m’fro denser les dimenches ? (Qui est-ce qui me consolera ? Qui est-ce qui me fera danser les dimanches ?)
— Qu’est-che qui rempliro m’hotte pour aller vendre à l’ville ? (Qui est-ce qui remplira ma hotte pour aller vendre à la ville ?)
— Ah ! mondiu, t’étois si vartillant près d’mi ; à présent, t’es cleué dens in’ boëte, et tu ne r’mues pu ! (Ah ! mon Dieu ! tu étais si vivant près de moi, à présent, tu es cloué dans une boîte, et tu ne remues plus).
Ces expressions de douleur étaient interrompues par les pleurs et les plaintes d’autres individus. Un père parlait de faire abattre la maison qu’il avait fait bâtir pour son fils, un autre de brûler les habits qu’il lui avait achetés. On se serait cru au milieu d’une population de la Gambie (pays d’Afrique enclavé dans le Sénégal). Cependant, les funérailles terminées, les affligés revinrent à la joie ; on entra dans les cabarets, on se passa les verres d’eau-de-vie de main en main, et les marins burent au repos de leurs frères en attendant le jour où ils subiraient peut-être le même genre de mort. »
Précisons également qu’il y avait deux populations différentes dans Cayeux : les habitants du bout d’aval qui cultivaient la terre et ceux du bout d’amont qui étaient marins, et que ces deux populations avaient peu de communications entre elles.
Pour simple mémoire, ajoutons qu’une baleine s’est échouée sur la côte devant Cayeux en 1810. Remarque : Il n’y a pas que des hommes qui soient des naufragés des mers.
Mais revenons aux tempêtes : surtout celle de la nuit du 9 au 10 mars 1842, un véritable ouragan qui provoqua des désastres épouvantables sur toute la côte, en particulier à Cayeux.
Du texte d’E. Prarond, j’ai tiré l’essentiel.
Un chasse-marée (bâtiment côtier à trois mâts) en provenance de Fécamp, de 48 tonneaux, avec 3 hommes d’équipage périt corps et biens à 4 km de la Pointe du Hourdel, tandis qu’à peu de distance, un bateau de pêche de Boulogne, drossé par le vent vers Le Crotoy, disparaissait avec ses hommes. Pendant ce temps, les femmes de Cayeux s’inquiétaient pour leurs maris et fils qui étaient en difficulté sur des barques mal construites ou mal lestées. Sur 15 bateaux sortis pour pêcher, seulement 9 rentrèrent. Les 6 autres furent engloutis, presque tous hors de vue de la côte. Ils avaient tenté de s’éloigner le plus possible au large pour ne pas s’échouer. Malheureusement, le lest de ces bateaux composé de galets ronds et roulants n’était pas arrimé. En s’accumulant d’un seul côté sous les assauts du vent, cette masse de pierre les avaient fait chavirer au-delà des bancs. La désolation fut générale dans Cayeux.
Deux jours après les naufrages, on avait relevé 12 cadavres sur la côte. Des femmes allaient, le soir, à la rencontre d’un chariot qui ramenait du Crotoy d’autres cadavres que la mer avait fait dériver sur la rive droite de la baie, compte tenu des vents d’ouest qui dominaient. On a raconté que, dans cette nuit, une femme avait vu rouler trois corps apparemment sans vie à ses pieds, sans autre mouvement que celui imprimé par les vagues les heurtant au cordon de galets de la côte. Ces trois corps étaient étroitement attachés par un câble. La dame reconnut ses deux fils et leur père. Par miracle, on put ramener ces trois marins à la vie.
D’autres épisodes tragiques étaient racontés de bouche à oreille, au milieu des sanglots et des larmes. Les souvenirs de cette funeste nuit qui fit tant de veuves et d’orphelins étaient encore vivaces à Cayeux dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il faut croire que chaque siècle a son drame exceptionnel, qu’il y a des tempêtes maritimes décennales comme il y a des inondations terrestres décennales.Pour preuves, ces brefs rappels :
1842 : tempête dramatique sur toute la côte picarde, et surtout à Cayeux, relatée ci-dessus.
1990 : en janvier, très forte tempête maritime qui éventre la digue du hâble d’Ault et inonde d’eau salée tous les bas-champs entre Cayeux et Ault. Le président de la république, François Mitterrand, s’était même rendu sur les lieux pour constater les dégâts, avait visité la ferme Vangrevelinge sur la route de Cayeux à Brutelles et avait été reçu à la mairie de Cayeux.
Pour les dramatiques inondations terrestres et fluviales, rappelons celles de 1841, de 1910 et celle récente de 2001 dont la vallée de la Somme et le Plateau Picard ont beaucoup souffert.
En matière de catastrophes maritimes, n’oublions pas le difficile et périlleux métier de marin.
A ce propos, mentionnons qu’un habitant du Crotoy nommé Pierre Devismes a relaté son expérience de marin-pêcheur dans un ouvrage intitulé « Un siècle de pêche en mer et en baie de Somme ».Gérard Devismes
Pour découvrir les ouvrages de cet auteur :
- La vallée sous les eaux,
Les inondations dans la vallée de la Somme et sur le plateau picard des origines à l’an 2002, essai.
- Notre village au temps jadis,
Vie quotidienne, activités, traditions, nature et histoire en Picardie maritime, essai.
- Bucolique vallée de Somme,
de la source du fleuve à son embouchure, essai.
- Histoire d'Abbeville
- Histoire de Saint-Valery-sur-Somme- Les hôtels particuliers d'Abbeville et autres bâtisses remarquables, essai.
- Histoire de l'abbevillois rural, essai.
- Mémoires d'un fils de paysan, roman.
- La baie, la belle et le berger, roman.- Histoires insolites de Picardie maritime, essai
- Picardie maritime insolite, essai.Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire
-
« Comment espérer des oiseaux qu’ils chantent si leurs bocages sont abattus ? »
Henry David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois.De l’avis de nos ancêtres, les oiseaux sont de plus en plus rares. Marius Devismes, patoisant picard et cressonnier en basse-vallée de Somme, qui vécut proche de la nature, sut aimer et protéger ces compagnons souvent sensibles, intelligents et drôles.
Ecoutons sa leçon : il y est question de petits “êtres” essentiels à nos sens avec leurs chants, leurs couleurs, leurs mœurs et leurs facultés à vivre libres ; puis à notre tour, aidons les oiseaux à survivre, nul doute qu’aujourd’hui
comme hier, ils nous « récompenseront au centuple ».
Le rouge-gorge : On l’appelle Marie Foéron, Foérouille ou Foéreuse. Chacun sait que c’est un grand ami des hommes. L’hiver, il nous suivait dans les cressonnières, tantôt sur les planches à couper, tantôt sur la brouette de la femme qui ramassait les bottes. Il y en avait un qui entrait pour manger avec nous dans la baraque. Il picorait les miettes de pain autour du poêle.
Les roitelets : Voici deux petites histoires de roitelets (Titcheux ou Rouspéteux comme nous les appelions).
A chacune de mes cressonnières, il y en avait dans les baraques et aux alentours. Leur nid était facile à découvrir. Quand on s’en approchait, ils faisaient des tic-tic à n’en plus finir.
Un jour, dans ma cressonnière de Cambron, un ouvrier nommé Granger avait accroché sa veste de pluie à un clou. Le matin, comme il se met à pleuvoir, il va la prendre et se met au travail. Une paire de minutes s’écoulent et je l’entends qui s’écrie : « Ben zut ! Eh bien, ça alors ! Un roitelet vient de sortir de ma poche ! » Il passe sa main à l’intérieur et s’exclame : « Un nid ! Il couve ! Qu’est-ce que je fais ? » Je lui réponds : « Remets la veste où elle était et prends-en une autre ».
Un quart d’heure plus tard, l’oiseau couvait à nouveau ses œufs.
Une autre fois, dans une autre cressonnière, à peu près le même événement… mais nous nous en sommes aperçus à temps. Le nid était placé dans la doublure du dos. Une manche du vêtement en cachait le trou. Nous étions obligés de la relever chaque fois que nous voulions voir couver la petite bête. Si nous ne l’apercevions pas, nous passions le doigt dans le trou pour savoir s’il était bien au nid. Il ne bougeait pas de place, comme s’il sentait que nous ne lui voulions pas de mal.
Bergeronnettes et coucous : Une fois, j’ai découvert une drôle d’affaire : un voyou de coucou avait pondu son œuf dans le nid d’une bergeronnette et l’œuf a éclos. Le sacré coucou n’était pas très sociable. Mauvais comme une teigne, il soufflait comme un coq mal pris, quand on l’approchait. Lorsqu’il s’est emplumé, ses parents sont venus le chercher et je ne l’ai plus revu.
Cela crève le cœur de voir des petits oiseaux donner la becquée à un grand benêt comme le coucou. Bien entendu, je n’aurais pas voulu le tuer car la nature y trouve son équilibre. Ce n’est pas de la faute des coucous s’ils ne peuvent pas nourrir leurs petits, c’est parce qu’ils mangent beaucoup de chenilles dont les poils s’accrochent dans leur gosier. Les père et mère peuvent avaler les poils, mais pas les jeunes qui s’en étouffent. Ah ! mes gentilles bergeronnettes, que je vous adore ! Quel grand amour vous avez pour vos bébés !
Pinsons - Histoire de Titi : J’ai eu, parmi eux aussi, de bons amis. Ecoutez l’histoire de Titi ! Je l’aimais comme un enfant. Il rentrait volontiers dans notre maison. Si la porte était fermée, il menait un train d’enfer pour qu’on lui ouvre. C’était un pinson des Ardennes. Il nous quittait tous les hivers pour aller je ne sais où, et nous le revoyions au bon temps. La deuxième année de notre rencontre, un matin alors que j’étais encore au lit, je susurre à ma femme : « Ecoute ! Voilà notre Titi revenu ! » Elle répond : « T’es pas fou ! Tous les oiseaux se ressemblent. » Je rétorque : « C’est mon Titi, je reconnais sa chanson. » Vite, je me lève et j’ouvre la porte. Mon Titi était là, sur le seuil, la tête de travers, l’œil fixé sur moi, qui semblait dire : « C’est bien moi ! Tu ne me reconnais pas ? » Tout de suite, je lui ai donné un peu de pain trempé dans du lait. Sa femelle venait aussi, mais elle était plus sauvage. Quand ils avaient leur nichée, le Titi faisait la navette de son nid à notre maison, il appelait jusqu’à ce que je lui donne de quoi nourrir ses petits. Nous avons eu sa visite pendant quatre ans. Et puis un jour, il est revenu avec une patte cassée. Chaque fois qu’il se posait à terre, il tombait. Deux ou trois jours plus tard, on ne l’a plus revu. J’ai appris que c’était un vaurien qui lui avait donné un coup de fronde. Et puis un coq a dû le dévorer. Pauvre Titi ! Que de chagrin on a eu de ta disparition !

Hirondelles : A cette époque-là, parmi les hirondelles qui bâtissaient leurs nids à la maison, j’avais un bon camarade : un mâle.
Nous étions matinaux tous les deux. Je me levais à quatre heures du matin, pour ravitailler mes clients. Aussitôt qu’il m’entendait, il venait tourniquer autour de moi. Curieux, il entrait de temps en temps dans notre maison. Je le reconnaissais entre toutes les hirondelles qui venaient se balader dans notre cour. Il couchait dans mon garage. Vers la fin de l’après-midi, il allait voir si tout le monde était rentré. Il faisait partie de la famille. Mais comme tout a une fin, nous ne l’avons plus revu, notre beau mâle d’hirondelle. Je garde un si bon souvenir de lui que, quand les demoiselles nous reviennent au printemps et que j’entends leur charabia dans la cour, je suis l’être le plus heureux du monde.
Linots, verdiers, pouillots, verlinots : Un oiseau malin et bon camarade, c’est le linot. Les cressonnières, ce sont leur garde-manger et ils n’oublient pas d’y bâtir leurs nids : parfois cinq ou six sur une dizaine de mètres carrés d’osier. Quand nos fosses à graines commençaient à mûrir, quel régal pour eux ! Il faut dire aussi que, quand nous semions le cresson, ils en ramassaient une bonne part. S’ils faisaient un peu de dégât, ils me donnaient en échange d’agréables récompenses : d’abord leurs charmantes chansons et surtout le spectacle de la couvaison dans d’admirables nids.
Verlinots, verdiers ou pouillots, pour moi ce sont les mêmes oiseaux. Le verlinot (verdier de son vrai nom) est un merveilleux siffleur. Mon fils me ressemble ; il aime les oiseaux. Il a élevé deux des verlinots tombés du nid. Il les a laissés en liberté dans sa maison. Un an plus tard, le premier s’est laissé dévorer par un coq en suivant mon fils au jardin. Le deuxième dormait dans une pochette de calendrier à la maison. Mais il allait là où il voulait, dans les autres pièces : c’était sa maison à lui. Il préférait le beurre au pain. Un jour de printemps, il a pris son envol pour rechercher une compagne. Deux ans plus tard, un matin alors que personne ne pensait plus à lui, ma belle-fille qui est institutrice est partie à l’école en laissant sa porte ouverte. A la récréation, elle a eu une surprise : le verdier était revenu, il passait l’inspection de la maison avec sa femelle.
Elle, elle s’est sauvée, mais lui s’en est allé dans la cuisine, afin de voir si rien n’avait changé et il s’est posé aux mêmes endroits qu’auparavant… Après deux ans d’absence, il avait retrouvé ses habitudes.
Où sont partis les oiseaux disparus ?
J’ai le cœur gros de ne plus les rencontrer sur mon chemin. Pour ce qui me concerne ce n’est rien car je suis vieux, mais pour les jeunes je ne vois pas l’avenir en rose, avec ce progrès qui cause tant de tort. Vous imaginez les arbres sans oiseaux ? J’ai bénéficié d’une vie heureuse à leurs côtés. Si j’ai dépensé un peu en achats de mangeaille pour les nourrir, j’ai été payé au centuple par leurs chansons. Je vous dis merci du fond du cœur, mes amis les oiseaux ! Alors quand je mourrai, priez votre Bon Dieu pour que je sois avec vous… dans votre Paradis.Marius Devismes
Extraits de :
 NOTRE VILLAGE AU TEMPS JADIS
NOTRE VILLAGE AU TEMPS JADIS
Vie quotidienne, activités, traditions,nature et histoire en PICARDIE MARITIME
Gérard Devismes
14 x 21 cm - 140 pages - Cartes postales anciennes.Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire
-
« Forges est un joli bourg d’un accès facile, situé au milieu de bois percés d’agréables promenades, et attirant chaque année un assez grand nombre d’étrangers qui viennent demander la santé à ses eaux minérales. C’est la renommée de ces eaux qui, aux XVIIe siècle, lui a valu la dénomination de Forges-les-Eaux. (M. l’abbé Decorde). »
L’église, sous le patronage de S. Eloi et de S. Nicolas, est un bâtiment sans caractère et sans goût, élevé en 1825. Il remplace une belle église romane de 1150 (suivant Guilmeth), en partie restaurée vers 1500, mais endommagée par un incendie au XVIIe siècle.
Une petite chapelle de S. Eloi, patron des forgerons, paraît avoir existé avant l’église du XIIe siècle. Plusieurs fois détruite par les guerres, elle a toujours été rebâtie, et subsiste encore aujourd’hui, mais ne sert plus au culte.
Quelques Capucins vinrent à Forges vers 1630, où on leur donna une maison pour y loger pendant leurs missions. Peu d’années après, ils y établirent un couvent aux frais du duc d’Orléans, et y restèrent jusqu’à la Révolution.
Forges (Forgiœ) doit son nom aux importants établissements métallurgiques qui y furent en activité dès le temps des Romains. Cela se prouve par les tuiles, les tuyaux en terre cuite et surtout les monnaies très abondantes (on en cite depuis Auguste jusqu’à Constance) qu’on a trouvées mêlées à des amas énormes de scories de fer.
L’extraction et la fabrication du fer continuèrent à Forges pendant tout le moyen-âge ; les ouvriers avaient le privilège de prendre gratuitement dans la forêt les manches de marteau et les pieds d’enclume. Ce fut seulement vers 1500 que les forges furent transportées à Beaussault, on ne sait trop pourquoi, puisque le minerai de fer est loin d’être épuisé à Forges et qu’on y en trouve encore de première qualité, suivant Guilmeth.
Le bourg de Forges est fort ancien. Suivant des conjectures assez probables, les Gaulois y auraient construit la grande enceinte défendue par un fossé d’environ 700 mètres de longueur, que l’on voit au triège des Minières.
Le sire de Forges prit part à la bataille d’Hastings en 1066 ; trente ans plus tard, Becquet de Forges était à la première croisade. Philippe de Forges fut tué au désastre de Poitiers (1356). La terre de Forges dépendait d’un fief royal qui s’étendait sur plusieurs paroisses.
Le château qui défendait Forges était situé sur la butte nominée le Donjon et entourée de vastes fossés. On croit qu’il fut investi en 1418 par 300 Anglais, qui le prirent après un siège de sept jours et dévastèrent tout le pays.
En 1607, un incendie dévora presque toutes les maisons du bourg et atteignit même l’église. Ici s’arrête l’histoire de Forges. On sait seulement par des pièces officielles de la fin du dernier siècle que sa municipalité voulait « se changer en république et ne reconnaître aucune autorité supérieure. » Les habitants en étaient réputés « les plus déraisonnables et les plus turbulents qu’il y ait dans la province. Aujourd’hui, les fils ne ressemblent point à leurs pères sous ce rapport, et Forges est une petite ville fort calme. Les eaux minérales ferrugineuses de Forges sont connus depuis plusieurs sièc1es. La tradition populaire attribue la découverte de leurs propriétés à la guérison d’un cheval abandonné dans la contrée par les moines de Beaubec. On assure également, mais sans preuves, que la reine Blanche de Navarre, seconde femme de Philippe de Valois, en fit usage dès le XIVe siècle.
Forges-les-Eaux, la place Brevière, gonflement d'un ballon.
Toutefois les sources ne commencèrent à être fréquentées que vers la fin du XVIe siècle ; on y venait alors de 50 lieues. L’ouverture de la saison des eaux se faisait solennellement par une procession suivie d’une grand'messe.
Enfin les eaux de Forges durent toute leur renommée au séjour qu’y fit Louis XIII (21 juin-13 juillet 1632), accompagné de la reine Anne d’Autriche et du cardinal de Richelieu. Anne d’Autriche y était venue chercher un remède à sa stérilité ; un siècle plus tard, la mère de Louis XVI y vint pour le même motif et fut la bienfaitrice du pays. Jusqu’à la Révolution, Forges fut fréquenté par les personnes les plus qualifiées de la Cour.
Parmi les visiteurs les plus illustres, on cite Mme de Sévigné, Mlle de Montpensier, Voltaire, qui aurait même écrit à Forges quelques-unes de ses œuvres, Buffon, Marivaux, Mme de Genlis, Napoléon Ier (alors premier consul), les duchesses d’Angoulême et de Berry et le roi Louis-Philippe---- Un vieux chêne du pays s’appelle encore l’arbre de Mlle de Sévigné. Cependant la présence à Forges de cette femme célèbre semble douteuse, car elle n'en parle point dans ses œuvres, bien que l’Eau de Forges y soit plusieurs fois nommée avec éloges. ----
Les sources, au nombre de trois ,portent les noms de Reinette, Royale et Cardinale, parce que la reine (Anne d’Autriche), le roi (Louis XIII) et le cardinal (de Richelieu) burent de préférence l’eau de chacune d’elles. La température des deux premières est de 7 à 7° ½ centigrades, et leur eau et limpide et sans odeur ; l’eau de la Cardinale un peu plus froide (6 à 6° ½) a un goût d’encre très prononcé et présente à sa surface une pellicule irisée, nommée crême de la source et recherchée des buveurs. La Cardinale donne 80 litres par heure, la Royale 450, et la Reinette 900.
Ces eaux sont toniques comme celles de Spa, pour lesquelles on les vend parfois. Elles sont surtout efficaces dans les maladies de langueur, conviennent aux tempéraments lymphatiques, et sont employées avec grand succès contre les douleurs qui affectent les organes digestifs. L’usage est d’en boire chaque jour, à la dose d’un verre jusqu’à 7 ; on commence par la Reinette, on continue par la Royale et on finit par la Cardinale, la plus active des trois (M. l'abbé Decorde).
Les eaux de Forges, dit M. Joanne, ont été trop délaissées en notre siècle. L’établissement des bains convient aux personnes amies du calme, et est entouré d’un beau parc bien planté, mais un peu humide. La forêt de Bray offre de charmantes promenades.
Forges est situé sur un sol très favorable aux études géologiques. Les coquilles d’huîtres, de moules, s’y trouvent en abondance, ainsi que d'énormes troncs d’arbres de 5 ou 6 mètres de longueur et enfouis parfois à une profondeur de 12 mètres.
Extraits de :

 NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
ET SON ARRONDISSEMENT
J. Bunel et A. Tougard
volume 1 : 15 x 21 cm - 222 pagesNeufchâtel-en-Bray, Aumale, Blangy-sur-Bresle et Londinières.volume 2 : 15 x 21 cm - 198 pagesArgueil, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray et Saint-Saëns.
avec cartes postales anciennes
Pour en savoir plus sur ces 2 livres...Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos... votre commentaire
votre commentaire
-
Chaque année, au moment des étrennes, les promeneurs curieux se pressent sur les boulevards devant les petites baraques, examinent longuement les nouveaux jouets de la saison, s’arrêtent aux boniments des marchands, se montrent friands des bibelots d’actualité scientifiques ou politiques. Si ces jouets savent intéresser les grandes personnes en même temps qu’ils amusent les enfants, ce n’est pas seulement par leurs formes ou les mouvements qui les animent, mais c’est surtout par l’ingéniosité vraiment remarquable des fabricants qui parviennent à créer, avec quelques bouts de bois, de fil de fer et d’étoffe, de véritables inventions. Ces inventions sont dues, pour la plupart, à de modestes artisans plus riches d’idées que de capitaux, qui luttent difficilement contre les grandes usines dont les machines produisent vite et à bon compte trois mille jouets par jour, neuf cent mille chaque année.
Mais si la fabrication mécanique intensive et la préparation manuelle naturellement lente des jouets permettent de constater, une fois encore, la suprématie du capital sur l’intelligence, elles nous donnent aussi l’occasion de faire des comparaisons intéressantes entre les moyens d’action des petits ouvriers en chambre et ceux des directeurs d’usines. Les premiers sont dignes en effet d’une curiosité bienveillante ; on ne peut s’empêcher d’estimer comme ils le méritent ces constructeurs de joujoux qui, pour garder leur ancienne liberté de travail, luttent avec courage contre la surproduction mécanique. Presque tous sont de pauvres ouvriers, visités plus souvent par le génie que par la fortune, et qui n’ont, pour travailler et mettre en œuvre leurs modèles, qu’un bout de table dans une mansarde. Ils habitent au Marais, dans de petits ateliers meublés généralement d’un établi, d’un poêle, d’une table et d’un lit, de plusieurs souvent, car les enfants sont nombreux dans ces intérieurs de travailleurs peu fortunés. C’est dans ce quartier, consacré par l’usage commercial à l’industrie des jouets, qu’il faut se rendre si l’on veut savoir comment se fabriquent les bibelots amusants que les camelots installent sur les boulevards au moment des étrennes. On y verra tous nos fabricants parisiens, aussi bien ceux qui construisent les petits trains en fer-blanc estampé, composés de vingt-neuf morceaux patiemment assemblés, et vendus au détail par les bazars 0 fr. 20 que ceux qui, plus fortunés, peuvent mouler en carton des soldats et des gendarmes articulés, peints et vernis, affichés à 0 fr. 40 chez les revendeurs, ou des jouets plus luxueux encore à 0fr. 60, 1 franc et 1 fr. 75. Cette année on pouvait voir, dans les petites baraques de bois ouvertes aux curiosités enfantines, des poupées mécaniques, habillées en clown ou en demoiselle, et qui semblaient faire automatiquement des petites bulles de savon. L’illusion pour les enfants était complète, et les gens raisonnables, en déshabillant le pantin, pouvaient apprécier la merveilleuse ingéniosité et les prodigieuses économies réalisées par les fabricants de ce jouet vendu 1 fr. 75. Lorsqu’on enlevait le vêtement de satin qui dissimulait élégamment l’anatomie constructive du faiseur de bulles, on trouvait une planche de bois à laquelle s’ajustaient des bras en fil de fer, des pieds et des mains en carton. Un tuyau de caoutchouc, partant d’un soufflet placé sous les pieds, aboutissait au tube de bois qui faisait les boules. Celles-ci étaient donc créées, non par la bouche, comme on pouvait le croire, mais par la main. Le véritable problème, pour les créateurs de ces jouets bon marché, c’est avant tout le prix de revient et les bénéfices possibles. Le prix de revient du faiseur de bulles de savon est de 1 fr. 45 et le décompte du modeste budget de cette usine miniature est amusant à citer. Les boîtes formant socle sont achetées au cartonnier, qui les livre en même temps que les corps en bois, pour 0 fr. 50 les deux pièces ; les soufflets s’achètent 8 francs la grosse, soit 0 fr. 08 pièce ; les tuyaux de caoutchouc coûtent 6 francs la livre ou 0 fr. 03 le mètre, un mètre suffisant à monter trois jouets ; les étoffes ont été achetées en solde 1 fr. 45 le mètre, et un mètre habille six pantins ; les cheveux sont faits avec de la natte, sorte d’étoupe tressée coûtant 0 fr. 55 le mètre, un mètre garnissant une douzaine de têtes ; les pieds s’achètent tout moulés 0 fr. 25 la douzaine de paires ; les têtes valent 1 fr.75 la douzaine ; les mains 0 fr. 05 les deux paires. Il n’est pas possible, paraît-il, de simplifier davantage les dépenses ; on pourrait les réduire encore cependant en supprimant un certain ressort qui force le soufflet à revenir sur lui-même à chaque pression des doigts ; mais ce ressort fait partie intégrale de la trouvaille de M. Raux, et pour l’économie de ce demi-sou il eut de longues discussions avec sa femme. Mais ils sont d’accord maintenant pour ne pas déprécier leur œuvre, et ils admirent naïvement ce fruit des longues nuits passées sans sommeil devant l’établi, sous la lampe. Le plaisir légitime que leur procure l’exécution plus ou moins parfaite de leurs idées se retrouve chez la plupart de ces petits producteurs de jouets, et si l’on va, toujours dans le Marais, rendre visite à un autre fabricant, M. Bessonnet, c’est avec une inépuisable bonne humeur qu’il vous explique ses travaux, vous raconte ses recherches pour trouver de nouveaux jouets. Son tir perpétuel coûte 2 fr. 95 au détail, il est livré aux camelots à 1 fr. 80 et, pour ce prix, il faut fournir de grandes boîtes de carton fermées et couvertes de papier ; les soldats découpés dans des images d’Épinal et collés sur carton avant leur montage sur charnières ; les différents accessoires, fil de fer, etc. ; pour s’en tirer il a fallu arriver à fabriquer quatre douzaines de tirs par jour, et le fabricant a dû se faire aider par deux ouvriers embauchés pendant les mois de presse. Ces mains-d’œuvre supplémentaires ne servaient pas seulement à la mise en œuvre des tirs, mais aussi à la fabrication des autres créations de leur patron temporaire, de sa trouvaille par excellence, son Santos-Dumont,non pas un dirigeable bâti de chic avec un ballonnet et une hélice à caoutchouc, mais une copie exacte du vrai Santos, celui du prix Deutch, le numéro 6. En sortant des intérieurs exigus dans lesquels les ouvriers peu fortunés s’acharnent à gagner quelques sous en exécutant eux-mêmes les bibelots qu’ils inventent, il est intéressant de connaître la grande fabrication, celle qui, très moderne, a su asservir à la préparation des jouets les procédés perfectionnés de la vapeur et de l’électricité. OUVRIER EN CHAMBRE TRAVAILLANT POUR LES CAMELOTS
OUVRIER EN CHAMBRE TRAVAILLANT POUR LES CAMELOTS
On ne se doute pas de la multiplicité des opérations nécessaires à la terminaison des automates tels que l’agent à bâton blanc, représenté en tête de ce chapitre, et qui avance sur les deux pieds, sans point d’appui supplémentaire, en agitant les bras. Un sergent de ville exige la combinaison de cent vingt-cinq mains appliquées à cent vingt-cinq opérations ou passes successives. C’est par dix mille par jour que l’ouvrier spécial estampe les feuilles de fer-blanc qui forment les corps ; après l’estampage une seconde machine enlève les bavures, perce les trous pour le montage des corps, des jambes et du mécanisme ; celui-ci se compose de trois ressorts, de quatre roues dentées, d’un échappement régulateur et de deux béquilles. Ces béquilles, mues par les roues comme des bielles, viennent, dans leur mouvement de va-et-vient, appuyer tour à tour sur le sol en poussant en avant le bonhomme que ses pieds de plomb retiennent en équilibre.
Lorsqu’ils sont montés, les petits agents passent au réglage. Rapidement huilés par une petite fille, les mécanismes sont vérifiés par deux régleurs qui n’acceptent que ceux dont le mouvement et l’équilibre paraissent parfaits. Après ce passage à la révision, les pantins vont à la peinture ; une ouvrière barbouille les têtes de blanc, une autre les teint de rose, une troisième dessine les yeux en deux coups de pinceau ; la moustache est l’œuvre d’une quatrième, et une cinquième met sur le képi du noir, du rouge et du blanc. Les agents sont amenés à la peinture par plateaux de cinquante, chaque ouvrière en exécute deux cents par jour. Peint, verni, le squelette va revêtir dans un atelier voisin le costume d’uniforme qui n’est ni d’essayage long ni de couture difficile. Pantalons, vestes et pèlerines sont ajustés en un tour de main et, toujours par fournées de cinquante, ils passent chez les colleuses dont l’une pose les trois boutons et les galons en papier d’argent, l’autre le ceinturon et la plaque, tandis qu’une troisième ajuste la main gauche en carton après la manche qui est flottante sans bras. Cent automates à l’heure sont terminés par les colleuses et livrés au dernier essayage des vérificateurs. Définitivement accepté, poinçonné, le sergent de ville peut prendre enfin possession de la boîte bleue et rouge, aux couleurs de la ville de Paris, qui lui sert de guérite.Extraits de :
Pierre Calmettes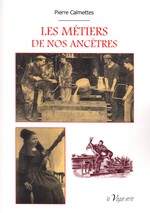 LES MÉTIERS DE NOS ANCÊTRES 15 x 21 cm - 306 pages - près de 200 dessins de l'auteur
LES MÉTIERS DE NOS ANCÊTRES 15 x 21 cm - 306 pages - près de 200 dessins de l'auteur
Pour en savoir plus sur ce livre...Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire




