-
Par éditionslavagueverte le 26 Mars 2020 à 06:00Chaque année, au moment des étrennes, les promeneurs curieux se pressent sur les boulevards devant les petites baraques, examinent longuement les nouveaux jouets de la saison, s’arrêtent aux boniments des marchands, se montrent friands des bibelots d’actualité scientifiques ou politiques. Si ces jouets savent intéresser les grandes personnes en même temps qu’ils amusent les enfants, ce n’est pas seulement par leurs formes ou les mouvements qui les animent, mais c’est surtout par l’ingéniosité vraiment remarquable des fabricants qui parviennent à créer, avec quelques bouts de bois, de fil de fer et d’étoffe, de véritables inventions. Ces inventions sont dues, pour la plupart, à de modestes artisans plus riches d’idées que de capitaux, qui luttent difficilement contre les grandes usines dont les machines produisent vite et à bon compte trois mille jouets par jour, neuf cent mille chaque année.
Mais si la fabrication mécanique intensive et la préparation manuelle naturellement lente des jouets permettent de constater, une fois encore, la suprématie du capital sur l’intelligence, elles nous donnent aussi l’occasion de faire des comparaisons intéressantes entre les moyens d’action des petits ouvriers en chambre et ceux des directeurs d’usines. Les premiers sont dignes en effet d’une curiosité bienveillante ; on ne peut s’empêcher d’estimer comme ils le méritent ces constructeurs de joujoux qui, pour garder leur ancienne liberté de travail, luttent avec courage contre la surproduction mécanique. Presque tous sont de pauvres ouvriers, visités plus souvent par le génie que par la fortune, et qui n’ont, pour travailler et mettre en œuvre leurs modèles, qu’un bout de table dans une mansarde. Ils habitent au Marais, dans de petits ateliers meublés généralement d’un établi, d’un poêle, d’une table et d’un lit, de plusieurs souvent, car les enfants sont nombreux dans ces intérieurs de travailleurs peu fortunés. C’est dans ce quartier, consacré par l’usage commercial à l’industrie des jouets, qu’il faut se rendre si l’on veut savoir comment se fabriquent les bibelots amusants que les camelots installent sur les boulevards au moment des étrennes. On y verra tous nos fabricants parisiens, aussi bien ceux qui construisent les petits trains en fer-blanc estampé, composés de vingt-neuf morceaux patiemment assemblés, et vendus au détail par les bazars 0 fr. 20 que ceux qui, plus fortunés, peuvent mouler en carton des soldats et des gendarmes articulés, peints et vernis, affichés à 0 fr. 40 chez les revendeurs, ou des jouets plus luxueux encore à 0fr. 60, 1 franc et 1 fr. 75. Cette année on pouvait voir, dans les petites baraques de bois ouvertes aux curiosités enfantines, des poupées mécaniques, habillées en clown ou en demoiselle, et qui semblaient faire automatiquement des petites bulles de savon. L’illusion pour les enfants était complète, et les gens raisonnables, en déshabillant le pantin, pouvaient apprécier la merveilleuse ingéniosité et les prodigieuses économies réalisées par les fabricants de ce jouet vendu 1 fr. 75. Lorsqu’on enlevait le vêtement de satin qui dissimulait élégamment l’anatomie constructive du faiseur de bulles, on trouvait une planche de bois à laquelle s’ajustaient des bras en fil de fer, des pieds et des mains en carton. Un tuyau de caoutchouc, partant d’un soufflet placé sous les pieds, aboutissait au tube de bois qui faisait les boules. Celles-ci étaient donc créées, non par la bouche, comme on pouvait le croire, mais par la main. Le véritable problème, pour les créateurs de ces jouets bon marché, c’est avant tout le prix de revient et les bénéfices possibles. Le prix de revient du faiseur de bulles de savon est de 1 fr. 45 et le décompte du modeste budget de cette usine miniature est amusant à citer. Les boîtes formant socle sont achetées au cartonnier, qui les livre en même temps que les corps en bois, pour 0 fr. 50 les deux pièces ; les soufflets s’achètent 8 francs la grosse, soit 0 fr. 08 pièce ; les tuyaux de caoutchouc coûtent 6 francs la livre ou 0 fr. 03 le mètre, un mètre suffisant à monter trois jouets ; les étoffes ont été achetées en solde 1 fr. 45 le mètre, et un mètre habille six pantins ; les cheveux sont faits avec de la natte, sorte d’étoupe tressée coûtant 0 fr. 55 le mètre, un mètre garnissant une douzaine de têtes ; les pieds s’achètent tout moulés 0 fr. 25 la douzaine de paires ; les têtes valent 1 fr.75 la douzaine ; les mains 0 fr. 05 les deux paires. Il n’est pas possible, paraît-il, de simplifier davantage les dépenses ; on pourrait les réduire encore cependant en supprimant un certain ressort qui force le soufflet à revenir sur lui-même à chaque pression des doigts ; mais ce ressort fait partie intégrale de la trouvaille de M. Raux, et pour l’économie de ce demi-sou il eut de longues discussions avec sa femme. Mais ils sont d’accord maintenant pour ne pas déprécier leur œuvre, et ils admirent naïvement ce fruit des longues nuits passées sans sommeil devant l’établi, sous la lampe. Le plaisir légitime que leur procure l’exécution plus ou moins parfaite de leurs idées se retrouve chez la plupart de ces petits producteurs de jouets, et si l’on va, toujours dans le Marais, rendre visite à un autre fabricant, M. Bessonnet, c’est avec une inépuisable bonne humeur qu’il vous explique ses travaux, vous raconte ses recherches pour trouver de nouveaux jouets. Son tir perpétuel coûte 2 fr. 95 au détail, il est livré aux camelots à 1 fr. 80 et, pour ce prix, il faut fournir de grandes boîtes de carton fermées et couvertes de papier ; les soldats découpés dans des images d’Épinal et collés sur carton avant leur montage sur charnières ; les différents accessoires, fil de fer, etc. ; pour s’en tirer il a fallu arriver à fabriquer quatre douzaines de tirs par jour, et le fabricant a dû se faire aider par deux ouvriers embauchés pendant les mois de presse. Ces mains-d’œuvre supplémentaires ne servaient pas seulement à la mise en œuvre des tirs, mais aussi à la fabrication des autres créations de leur patron temporaire, de sa trouvaille par excellence, son Santos-Dumont,non pas un dirigeable bâti de chic avec un ballonnet et une hélice à caoutchouc, mais une copie exacte du vrai Santos, celui du prix Deutch, le numéro 6. En sortant des intérieurs exigus dans lesquels les ouvriers peu fortunés s’acharnent à gagner quelques sous en exécutant eux-mêmes les bibelots qu’ils inventent, il est intéressant de connaître la grande fabrication, celle qui, très moderne, a su asservir à la préparation des jouets les procédés perfectionnés de la vapeur et de l’électricité. OUVRIER EN CHAMBRE TRAVAILLANT POUR LES CAMELOTS
OUVRIER EN CHAMBRE TRAVAILLANT POUR LES CAMELOTS
On ne se doute pas de la multiplicité des opérations nécessaires à la terminaison des automates tels que l’agent à bâton blanc, représenté en tête de ce chapitre, et qui avance sur les deux pieds, sans point d’appui supplémentaire, en agitant les bras. Un sergent de ville exige la combinaison de cent vingt-cinq mains appliquées à cent vingt-cinq opérations ou passes successives. C’est par dix mille par jour que l’ouvrier spécial estampe les feuilles de fer-blanc qui forment les corps ; après l’estampage une seconde machine enlève les bavures, perce les trous pour le montage des corps, des jambes et du mécanisme ; celui-ci se compose de trois ressorts, de quatre roues dentées, d’un échappement régulateur et de deux béquilles. Ces béquilles, mues par les roues comme des bielles, viennent, dans leur mouvement de va-et-vient, appuyer tour à tour sur le sol en poussant en avant le bonhomme que ses pieds de plomb retiennent en équilibre.
Lorsqu’ils sont montés, les petits agents passent au réglage. Rapidement huilés par une petite fille, les mécanismes sont vérifiés par deux régleurs qui n’acceptent que ceux dont le mouvement et l’équilibre paraissent parfaits. Après ce passage à la révision, les pantins vont à la peinture ; une ouvrière barbouille les têtes de blanc, une autre les teint de rose, une troisième dessine les yeux en deux coups de pinceau ; la moustache est l’œuvre d’une quatrième, et une cinquième met sur le képi du noir, du rouge et du blanc. Les agents sont amenés à la peinture par plateaux de cinquante, chaque ouvrière en exécute deux cents par jour. Peint, verni, le squelette va revêtir dans un atelier voisin le costume d’uniforme qui n’est ni d’essayage long ni de couture difficile. Pantalons, vestes et pèlerines sont ajustés en un tour de main et, toujours par fournées de cinquante, ils passent chez les colleuses dont l’une pose les trois boutons et les galons en papier d’argent, l’autre le ceinturon et la plaque, tandis qu’une troisième ajuste la main gauche en carton après la manche qui est flottante sans bras. Cent automates à l’heure sont terminés par les colleuses et livrés au dernier essayage des vérificateurs. Définitivement accepté, poinçonné, le sergent de ville peut prendre enfin possession de la boîte bleue et rouge, aux couleurs de la ville de Paris, qui lui sert de guérite.Extraits de :
Pierre Calmettes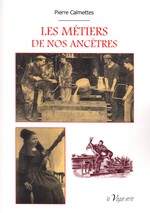 LES MÉTIERS DE NOS ANCÊTRES 15 x 21 cm - 306 pages - près de 200 dessins de l'auteur
LES MÉTIERS DE NOS ANCÊTRES 15 x 21 cm - 306 pages - près de 200 dessins de l'auteur
Pour en savoir plus sur ce livre...Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par éditionslavagueverte le 24 Mars 2020 à 06:00

Guillaume le Conquérant
Depuis tantôt un grand siècle, les Normands s’étaient établis dans l’ancien royaume de Neustrie ; sous le règne de ces habiles ducs de Normandie, la riche province était devenue la rivale heureuse du royaume de France. Affermis sur ce trône par leur prudence, heureux et fiers de commander aux plus braves soldats du monde, les ducs de Normandie avaient agrandi, au-delà de toute mesure, cette autorité si bien commencée. Du dixième au onzième siècle, vous retrouvez en tout lieu et en toute occasion nouvelle l'influence normande : l'Italie leur appartient pour une bonne part, l'Allemagne et la Flandre sont intéressées par des alliances, au règne de ces conquérants ; le Bas-Empire à tremblé devant ces guerriers redoutables ; bientôt, quand l'Angleterre sera conquise, vous verrez le Danemark et la Suède, la Norvège et l'Espagne, l'Écosse et l'Irlande, dominés par l'autorité de ce vassal-roi, devant qui la France s'incline avec crainte. – Cette idée de la Grande-Bretagne à conquérir avait fait battre le cœur de tous les ducs de Normandie, à commencer par Rollon lui-même. C'était là, pour nous servir d'une admirable expression de M. de Lamartine, la dot que chacun d'eux apportait à la fortune de son duché. Il était moins difficile, peut-être, aux Saxons de prendre l'Angleterre que de prendre la Normandie au fils de Charlemagne ! Voilà ce que se disait le jeune duc Guillaume de Normandie, chaque fois que son regard sérieux se portait du côté de cette île de la Grande-Bretagne, qui se montrait à lui sous les apparences de trois royaumes. Déjà, à seize ans, le fils d'Arlette annonçait le grand politique et l'habile capitaine qui devait réaliser les rêves de sa maison. Sa taille haute et fière, son noble visage, son esprit pénétrant et vif, sa colère subite et terrible, ses longues rancunes, sa prévoyance, son courage, sa patience dans les temps difficiles, n'avaient pas échappé aux moins clairvoyants. Qui lui résistait, était brisé ; qui lui était ami, pouvait se fier à ses promesses. Entouré de vassaux, trop puissants pour rester obéissants à leur seigneur, il châtia les plus fiers, il bannit les moins dociles, enseignant aux uns et aux autres l'obéissance et le respect. C'était sa maxime favorite que « les Normands veulent être gouvernés ; donnez-leur un maître habile, ils sont invincibles ; lâchez le frein, ils se perdent les uns les autres dans mille séditions. »
Guillaume “le bâtard”
On sait que Guillaume II, surnommé le Bâtard, naquit d’un commerce illégitime entre le duc Robert et Arlette, fille de Foubert, pelletier, d’autres disent brasseur et bourgeois de Falaise. « Le duc Robert étant un jour à Falaise vit une fort belle et gracieuse damoiselle nommée Arlette, fille d'un bourgeois de la ville, laquelle fut si bien à sa grâce qu'il la voulut avoir pour amoureuse ». Après un récit beaucoup trop naïf pour être rapporté, le chroniqueur ajoute : « Une nuit, Arlette songea que de son corps issoit un arbre croissant vers le ciel, si grand qu'il ombrageoit toute la Normandie. »
Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par éditionslavagueverte le 23 Mars 2020 à 06:00

La Rue des Tanneurs à Amiens
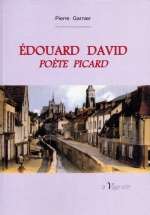 ÉDOUARD DAVID, POÈTE PICARD
ÉDOUARD DAVID, POÈTE PICARD
Pierre Garnier
14 x 21 cm - 150 pages - Réédition d'une étude parue en 1970 et épuisée.Pour en savoir plus sur ce livre...
Extraits :
Le chantre de Saint-Leu
Edouard David est le chantre de Saint-Leu comme Mistral fut le chantre de la Provence.
Pendant de nombreux siècles, Saint-Leu était Amiens ; au-delà de la Cathédrale s’étendaient les monastères, leurs dépendances, puis les campagnes. Avant que la Haute-Ville ne fût créée, la Basse-Ville avait été la Samarobrive des Gaules, César avait tenu là une assemblée générale, Antonin et Marc-Aurèle l’avaient agrandie, les rois francs y avaient séjourné, Mérovée y avait été, dit-on, élu roi... L’emplacement de l’Hôtel de Ville et son quartier, précise de Calonne, était « l’apanage du maître de la Cité » qu’il soit Romain, comte ou bourgeois triomphant.
La Basse-Ville, prise plus tard entre la Cathédrale et la Citadelle, n’allait guère se modifier jusqu’à une époque récente :
« Les documents du XIIIe, et du XIVe siècles, affirme Albéric de Calonne, révèlent l’existence à cette époque de la plupart de nos rues actuelles ; les rues malsaines et tortueuses, si l’on excepte les trois grandes et larges voies de la Porte Saint-Denis, des Vergeaux et du « markié as frommages », récemment enveloppées dans l’enceinte ; rues fangeuses en hiver et poudreuses en été ; rues que leur situation ou la gaieté hilare des aïeux ont fait baptiser de noms parfois grotesques : la Queue-de-Vache, les Tripes, la Canteraine, les Blanches-Mains, etc.A droite et à gauche de la « Cauchie au bled » les ruelles se rétrécissent. Plus de toits en pignon, les étages surplombants en saillie interceptent le jour et l’air et les maisons s’avancent jusqu’au bord des canaux que la nature a multipliés ainsi qu’en une « petite Venise ». Sur ces canaux les générations passées ont, avec l’agrément du chapitre, établi, ici pour moudre le grain, là pour fouler le drap, plus loin pour broyer la guède, des moulins dont le bruit assourdit le voisinage, et elles ont jeté de nombreux ponts de bois emportés quelquefois par une crue soudaine : celui, par exemple, ou Dieu ne passe oncques, entre les paroisses Saint-Leu et Saint-Sulpice, ainsi nommé parce que les prêtres qui portent le Saint-Sacrement aux malades dans l’étendue de leurs circonscriptions respectives ne le traversent jamais... »
Cependant, dès le début du XIXe siècle, le quartier Saint-Leu, devenu excentrique, se dépeuple des quelques familles aisées qui y habitaient : elles émigrent vers les quartiers plus salubres. La ville basse est abandonnée aux artisans d’abord, puis aux ouvriers des moulins et au prolétariat le plus misérable, dont le nombre grossira au cours du siècle par l’immigration paysanne.Une Cour des Miracles
En 1856, Louis Fée, soutenant le projet d’une rue centrale de vingt mètres de large devant relier les deux ports d’Aval et d’Amont à la gare de marchandises, constate que « le quartier Saint-Leu se meurt » et qu’on ne fait rien pour le sauver ; il dénonce les spéculations sur les logements insalubres et accuse les propriétaires de les louer sur un loyer calculé à 10 ou 15 % de leur prix d’achat, alors qu’à Henriville le taux est au plus de... 5 %!
« Comment décrire, dit Albéric de Calonne, les amas de maisons ventrues, bossues, déjetées, se portant l’une sur l’autre, quelques-unes avec étage auquel un escalier hors d’aplomb avec porte sur la rue, donne péniblement accès ; vieilles la plupart de deux ou trois siècles, aux façades noires, sordides et délabrées ; maisons faites d’armatures de bois, garnies de briques et de torchis, aux ouvertures pratiquées sans le moindre souci de la symétrie mais combien pittoresques !
Comment décrire encore les toitures hautes et pointues, et les étages qui surplombent, et les abouts des poutres historiées en corbeaux à tête grotesque, et les fenêtres à coulisses aux châssis garnis, en maints endroits, de papier huilé en guise de vitres !...
Tout ce que la ville comptait de misérables, borgnes, aveugles, éclopés, manchots, culs-de-jatte, plus ou moins déguenillés, joueurs de serinettes et d’orgues de Barbarie habitait le quartier des Bondes « ch’Caban », dédale obscur circonscrit entre la place du Don, la rue du Hocquet ; le pont du Cange et la Somme.
M. David en a dépeint d’une façon plus humoristique peut-être que nature, la population qui donnait « à certaines heures l’impression d’une mer agitée » :
« Chaque matin, elle s’épandait à travers les rues d’Amiens pour demander l’aumône. La rentrée au quartier de tous ces miséreux présentait un tableau unique. Aussitôt, leurs sacs étaient vidés et le pain mis en commun. Solidaires, ils l’étaient non par calcul, mais par instinct, car il n’y avait chez eux aucune combinaison d’intérêt. La matinée avait-elle été fructueuse ? Tant mieux. On mangeait double ration. Les aumônes s’étaient-elles faites plus rares ? Tant pis. Les querelles et les disputes inséparables d’un portage difficile naissaient alors, et les querelles c’était même de la joie. Au plus fort de la tourmente, quand le tumulte était au comble, les serinettes et les orgues de Barbarie apparaissaient tout à coup, jetant leurs accords joyeux et bruyants dans ce charivari, et désarmaient les compétiteurs... »
De Calonne ajoute d’ailleurs qu’à côté de cette bohème qui erre en cherchant aventure et qui trouve commode de vivre de la charité publique, la ville basse voit s’entasser, dans le dédale de ses rues, une population ouvrière vaillante et honnête qui ne ménage ni ses peines, ni son activité.
Cette population a ses coutumes, ses fêtes, sa langue ; elle a aussi ses théâtres « salles basses, mal éclairées, plus mal aérées, magasins ou dessous de portes aménagés pour les représentations toujours très suivies des «Cabotins».Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par éditionslavagueverte le 22 Mars 2020 à 06:00
Notre envoyé spécial a retrouvé un vieux journal imprimé à l’encre sépia, daté du 1er mars 1954, intitulé : «Détective » et sous-titré : « L’hebdomadaire des secrets du monde », où un journaliste relate sa rencontre avec quelques curieux personnages qui aux environs de la baie d’Authie sont à cette époque là à la conquête d’un trésor...
Il y a d’abord M. Lucien Anger, propriétaire terrien et représentant de commerce, demeurant à Quend. C’est lui qui a le premier repéré l’emplacement de l’épave du Galion chargé d’or grâce à ses dons de radiesthésiste. Bien sûr il donne la raison de sa découverte.
L’histoire du bateau chargé d’or qui s’est échoué au large de la pointe de Saint-Quentin à la fin du XVIIe siècle, était demeurée vivace, bien qu’endormie. Je m’y suis intéressé. A l’aide d’une baguette de coudrier, d’abord ; puis de la double lame d’acier que voici, j’ai repéré l’emplacement du navire, sur la carte, puis sur le littoral même, à marée basse. On peut détecter le métal précieux en tenant à la main une pièce d’or qu’on applique sur l’une des branches du détecteur au moment de la recherche. Le bateau gît sous dix ou douze mètres de sable, au large de la dune de Saint-Quentin. Il recèle une quantité d’or assurément considérable.
Oh ! cette découverte ne lui a pas vraiment tourné la tête, « il en faut plus pour troubler le robuste équilibre picard ». Non cette histoire l’amuse plutôt quoique nous verrons bientôt que son affaire est sérieuse... Quant à Madame Anger son épouse, elle n’apprécie guère le journaliste et maudit assez cette sombre histoire de trésor. Ça lui fait perdre du temps, dit-elle avec humeur. Et puis, les vrais trésors, ce n’est pas en fouillant la mer qu’on les trouve ; c’est en labourant les champs...
Cependant M. Anger persiste et donne même de secrètes précisions : « Le certain c’est que le bateau est là, à quatorze mètres de profondeur. J’ai pu même en déterminer la trace. Il a onze mètres de long, sur quatre mètres de large. Des collègues radiesthésistes du Pas-de-Calais, venus à leur tour sur les lieux, sont arrivés aux mêmes
conclusions que moi... »
Il y a aussi Mme Madeleine Desmare qui habite Saint-Quentin-en-Tourmont, elle est elle aussi propriétaire terrienne, mais surtout, c’est l’héritière des « histoires locales ». D’ailleurs Madame Desmare connaît les textes, ceux sur lesquels s’appuient les partisans du trésor. Elle dévoile au journaliste le vénérable bouquin jauni, dont les feuilles mal reliées se détachent.
Ouvrage relativement récent, cependant. C’est la Géographie historique et populaire des communes de l’arrondissement d’Abbeville, de Florentin Lefils, édité en 1868. On peut y lire, à la page 362 : « Les naufrages étaient autrefois fréquents sur notre côte. La région des dunes de Saint-Quentin est pavée de carcasses de navires de diverses époques, depuis les temps les plus reculés. Un navire, de l’Invincible Armada s’y échoua lors du désastre de cette flotte, et le roi de France, à cause de son alliance avec le roi d’Espagne, remit au capitaine dudit vaisseau échoué tout ce qu’il pouvait prétendre. A la fin du siècle dernier, un navire chargé de lingots d’or s’ensablait et s’enfonçait à la Pointe de Saint-Quentin sans qu’on pût rien retirer de sa riche cargaison. Il disparut, enfoui sous plusieurs mètres de sable ; et il y est encore. »
Dans l’aventure (et dans l’inventaire) il y a également M. Frédéric Grenier, maire du pays qui déclare simplement :
— Ces recherches vont faire travailler des ouvriers, et attirer ici touristes et curieux. Car bien entendu ; des recherches vont être entreprises... Une société par actions, l’Unité, s’est constituée à Berck, en vue de financer les travaux nécessaires à la récupération de l’épave dès le printemps qui est confiée à l’entreprise Chartiez de Béthune. Neuf actionnaires ont souscrit le million de francs tout net (d’où le titre de l’Unité donné à leur affaire) par eux jugé nécessaire à l’engagement des travaux : commerçants, négociants, entrepreneurs de travaux publics, cultivateurs, fonctionnaire des douanes... les neuf mousquetaires (s’appellent-ils plaisamment eux-mêmes) nous ont demandé de taire leurs noms. Cent actions de dix mille francs chacune... et qui devraient, chacune, rapporter vingt-cinq millions à leur détenteur, si la quantité d’or décelée était un jour récupérée.
Il y a encore M. Pichon, l’un des plus anciens habitants de cette région, qui affirme, lui :
— Rien ne s’oppose à ce que deux navires chargés d’or se soient échoués, à quelques kilomètres l’un de l’autre, sur nos côtes sableuses et embrumées. Mais je suis fort heureux que les travaux de recherchent ne s’orientent pas vers notre baie, pour le moment. Ils en auraient chassé canards, sarcelles et bécassines. Ce n’est pas le métal jaune qui m’aurait consolé de leur perte !
A la question posé par le journaliste à M. Anger :
— Vous n’avez pas souscrit à l’Unité ?
M. Anger répond :
— Je suis l’inventeur du trésor, monsieur ! Je n’ai pas besoin de souscrire pour avoir droit demain à ma part, si la fortune, grâce à moi, sort des eaux, ou plutôt du sable !
Quant à Mme Desmare, détentrice du « vieux grimoire » où l’on relate la présence de 3 milliards d’or sous le sable, elle affirme clairement :
— Monsieur, durant toute mon enfance, mes grands-parents et mes parents m’ont parlé de ce bateau, auquel personne ne pensait plus et nous avons passé des jours et des jours à chercher sa trace par les dunes. Si l’on doit le retrouver demain, il sera fort juste que je fasse toutes réserves sur mes droits éventuels à une part de la cargaison...
Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par éditionslavagueverte le 21 Mars 2020 à 11:17

Le beffroi de Saint-Riquier
La construction communale qui sans doute fut élevée la première, celle dont la possession est surtout significative, c’est le beffroi. Il est essentiellement le réceptacle d’un des attributs fondamentaux de la commune, de la cloche, “ du ban ”, qui sert à convoquer les communiers, les jurés. La reconnaissance du droit à la
cloche, c’est celle du droit à la commune. Ainsi le beffroi devient l’affirmation matérielle, le symbole de l’indépendance absolue. Il servira à d’autres usages que le logement de la cloche : il sera tour de guet, prison, chartrier, recevra d’autres cloches que celles du ban, tout un carillon ou bien, assez tôt, dès le XIVe siècle sans doute, une horloge monumentale. Ce sont des fonctions accessoires... Le rôle essentiel du beffroi qui domine la silhouette de la ville, les pignons accolés des maisons et même les clochers de paroisses ou de couvents, c’est de rappeler aux gens du “ pays plat ” environnant, d’apprendre aux étrangers qui s’approchent des portes que, dans l’ombre de cette haute tour, vivent des “ bourgeois ” dont les aïeux ont acquis, à prix de sang ou d’argent, la plus large part d’autonomie collective, les plus grandes garanties individuelles qui aient été possédées au Moyen âge.Le beffroi est le donjon des “ bourgeois ” ; formant une véritable “ seigneurie populaire ”, ils ont les attributs seigneuriaux, le sceau, les armes, le donjon.
... C’est une tour carrée, trapue, aux murs pleins, que le plus ancien beffroi conservé en Picardie, celui d’Abbeville réédifié en 1209. Le même plan est encore celui du beffroi de Saint-Riquier et du plus récent beffroi que l’on achevait de couvrir à Rue en 1506.
Parfois le beffroi a été établi au-dessus d’une porte de la ville : notre région offre un exemple de ce parti à Lucheux, près de Doullens : la tour en pierres, du XVe siècle, est portée par une grande arche sous laquelle passe une route un peu rétrécie.
... La girouette des beffrois est, comme le beffroi lui-même, un signe d’indépendance, de noblesse communale : les châteaux avaient leurs girouettes découpées en flammes, en pennons, en bannières. Celle du beffroi a dû très rarement représenter un insigne du chef de la commune, le maïeur ; cependant une girouette en forme de toque était fixée à la pointe du beffroi d’Amiens, jusqu’au XVIIIe siècle.
Le beffroi, logis de la cloche et donjon communal, avait, nous l’avons vu, des rôles accessoires.
Les archives y étaient conservées. Dans le “trésor ” ou “ secret ”, derrière de fortes grilles, des coffres bardés de lames de fer étaient fermés par plusieurs serrures différentes ; autant de magistrats devaient aider à leur ouverture lorsqu’il fallait consulter les titres des libertés, chartes signées du Roi ou du seigneur, ou les registres qui étaient les codes, chaque jour complétés de la ville. « Le trésor était une véritable sacristie communale. » A Abbeville, la “ trésorerie ”, accolée au beffroi, est une grande salle voûtée d’ogives, du XVe siècle, dont la grande fenêtre est garnie d’une grille armoriée.
Les beffrois étaient aussi des prisons : dans ceux qui ne servaient pas d’hôtel de ville, les cachots occupent les étages, dans tous, le rez-de-chaussée et parfois des souterrains. Ces cachots sont encore utiles aujourd’hui : les menus délinquants, les ivrognes, en sont les hôtes ordinaires.
... Le beffroi est toujours un poste de guetteurs : au sommet est aménagée sa logette, la “guette” d’autrefois. Amiens avait deux guetteurs, deux “ waites ”, l’un de jour, l’autre de nuit. Tous deux devaient avertir des incendies ; le “ waite ” de jour signalait les approches des troupes pendant les périodes de guerres, en agitant une
bannière blanche dans la direction de la porte vers laquelle le groupe semblait se diriger.
... Si, au début de la commune, une seule cloche, la “ bancloque ”, était pendue au beffroi, le développement de la vie sociale et économique justifia bientôt la nécessité de plusieurs autres. Au beffroi d’Amiens, au XVIe siècle, il y avait quatre cloches, différentes de poids pour qu’elles fussent différentes de son : l’un servait à sonner “ l’échevinage ”, (c’est-à-dire à convoquer le Conseil de la Ville), c’est la très vieille “ bancloque ”. La seconde avait été pendue en 1335 ; elle était mise en branle «lorsqu’il étoit besoing que les ouvriers aillent à l’ouvrage » ou qu’ils en reviennent : elle fixait la durée officielle de la journée de travail dont la réglementation n’est certes pas une nouveauté. La troisième avait un rôle moins précis : au XVIe siècle, elle annonçait « qu’il sera venu du poisson et qu’on vende le blé. ». La dernière était “ le grant cloque ”, la cloche de “ l’effroy ”. Elle ne sonnait que lors des sinistres et des périls. Au moyen âge, elle avait dû accompagner de son glas les solennels bannissements. Tel était le “ jeu ” amiénois « pour la commodité, seureté et conservation d’icelle ville et du bien publicq. ».
Les beffrois de Picardie n’avaient pas de carillon, comme ceux de Flandre, mais à la fin du moyen âge les accents d’une musique moins impressionnante que les voix graves ou légères des cloches flamandes, tombaient parfois de la logette du guetteur. A Amiens, le waite de nuit devait d’abord « sonner son cornet par nuict de demie-heure en demie-heure afin que l’on cognoisse qu’il fait bon guet. » Ce rappel lugubre,
au-dessus de la ville endormie, n’était vraiment pas de la musique. Mais il lui fallait encore, avant d’emboucher son cornet de nuit ou en le déposant pour douze heures, « pipper de la pippette (sorte de flûte de métal), à la derraine (à la cloche du soir), et à la cloque du jour (à celle du matin) ». Le waite pipait aussi, sans arrêt, durant le passage devant le beffroi des grandes processions de l’Ascension, de la Fête-Dieu, pendant les nuits de Noël, de la Toussaint.
Pipettes ou trompettes ne pouvaient avoir que des sons bien grêles : les Picards étaient moins difficiles que leurs voisins les Flamands, dont les fils se réunissent encore chaque dimanche au pied du beffroi, les oreilles tendues aux larges chants du carillon.
Pierre Dubois.
Beffrois et Hôtels de Ville dans le Nord de la France, 1909Vous aimez nos lectures, abonnez-vous à notre Lettre d'infos...
 votre commentaire
votre commentaire




