-
Par éditionslavagueverte le 21 Décembre 2023 à 07:00

Les fabricants de jouets parisiens
Chaque année, au moment des étrennes, les promeneurs curieux se pressent sur les boulevards devant les petites baraques, examinent longuement les nouveaux jouets de la saison, s’arrêtent aux boniments des marchands, se montrent friands des bibelots d’actualité scientifiques ou politiques. Si ces jouets savent intéresser les grandes personnes en même temps qu’ils amusent les enfants, ce n’est pas seulement par leurs formes ou les mouvements qui les animent, mais c’est surtout par l’ingéniosité vraiment remarquable des fabricants qui parviennent à créer, avec quelques bouts de bois, de fil de fer et d’étoffe, de véritables inventions. Ces inventions sont dues, pour la plupart, à de modestes artisans plus riches d’idées que de capitaux, qui luttent difficilement contre les grandes usines dont les machines produisent vite et à bon compte trois mille jouets par jour, neuf cent
mille chaque année.Mais si la fabrication mécanique intensive et la préparation manuelle naturellement lente des jouets permettent de constater, une fois encore, la suprématie du capital sur l’intelligence, elles nous donnent aussi l’occasion de faire des comparaisons intéressantes entre les moyens d’action des petits ouvriers en chambre et ceux des directeurs d’usines.
Les premiers sont dignes en effet d’une curiosité bienveillante ; on ne peut s’empêcher d’estimer comme ils le méritent ces constructeurs de joujoux qui, pour garder leur ancienne liberté de travail, luttent avec courage contre la surproduction mécanique. Presque tous sont de pauvres ouvriers, visités plus souvent par le génie que par la fortune, et qui n’ont, pour travailler et mettre en œuvre leurs modèles, qu’un bout de table dans une mansarde.
Ils habitent au Marais, dans de petits ateliers meublés généralement d’un établi, d’un poêle, d’une table et d’un lit, de plusieurs souvent, car les enfants sont nombreux dans ces intérieurs de travailleurs peu fortunés. C’est dans ce quartier, consacré par l’usage commercial à l’industrie des jouets, qu’il faut se rendre si l’on veut savoir comment se fabriquent les bibelots amusants que les camelots installent sur les boulevards au moment des étrennes.
On y verra tous nos fabricants parisiens, aussi bien ceux qui construisent les petits trains en fer-blanc estampé, composés de vingt-neuf morceaux patiemment assemblés, et vendus au détail par les bazars 0 fr. 20 que ceux qui, plus fortunés, peuvent mouler en carton des soldats et des gendarmes articulés, peints et vernis, affichés à 0fr. 40 chez les revendeurs, ou des jouets plus luxueux encore à 0 fr. 60, 1 franc et 1 fr. 75.
Cette année on pouvait voir, dans les petites baraques de bois ouvertes aux curiosités enfantines, des poupées mécaniques, habillées en clown ou en demoiselle, et qui semblaient faire automatiquement des petites bulles de savon. L’illusion pour les enfants était complète, et les gens raisonnables, en déshabillant le pantin, pouvaient apprécier la merveilleuse ingéniosité et les prodigieuses économies réalisées par les fabricants de ce jouet vendu 1 fr. 75.Lorsqu’on enlevait le vêtement de satin qui dissimulait élégamment l’anatomie constructive du faiseur de bulles, on trouvait une planche de bois à laquelle s’ajustaient des bras en fil de fer, des pieds et des mains en carton. Un tuyau de caoutchouc, partant d’un soufflet placé sous les pieds, aboutissait au tube de bois qui faisait les boules.
Celles-ci étaient donc créées, non par la bouche, comme on pouvait le croire, mais par la main.
Le véritable problème, pour les créateurs de ces jouets bon marché, c’est avant tout le prix de revient et les bénéfices possibles.[...]
On ne se doute pas de la multiplicité des opérations nécessaires à la terminaison des automates tels que l’agent à bâton blanc, représenté en tête de ce chapitre, et qui avance sur les deux pieds, sans point d’appui supplémentaire, en agitant les bras. Un sergent de ville exige la combinaison de cent vingt-cinq mains appliquées à cent vingt-cinq opérations ou passes successives.
C’est par dix mille par jour que l’ouvrier spécial estampe les feuilles de fer-blanc qui forment les corps ; après l’estampage une seconde machine enlève les bavures, perce les trous pour le montage des corps, des jambes et du mécanisme ; celui-ci se compose de trois ressorts, de quatre roues dentées, d’un échappement régulateur et de
deux béquilles. Ces béquilles, mues par les roues comme des bielles, viennent, dans leur mouvement de va-et-vient, appuyer tour à tour sur le sol en poussant en avant le bonhomme que ses pieds de plomb retiennent en équilibre.Lorsqu’ils sont montés, les petits agents passent au réglage. Rapidement huilés par une petite fille, les mécanismes sont vérifiés par deux régleurs qui n’acceptent que ceux dont le mouvement et l’équilibre paraissent parfaits. Après ce passage à la révision, les pantins vont à la peinture ; une ouvrière barbouille les têtes de blanc, une autre les teint de rose, une troisième dessine les yeux en deux coups de pinceau ; la moustache est l’œuvre d’une quatrième, et une cinquième met sur le képi du noir, du rouge et du blanc. Les agents sont amenés à la peinture par plateaux de cinquante, chaque ouvrière en exécute deux cents par jour.
Peint, verni, le squelette va revêtir dans un atelier voisin le costume d’uniforme qui n’est ni d’essayage long ni de couture difficile.
Pantalons, vestes et pèlerines sont ajustés en un tour de main et, toujours par fournées de cinquante, ils passent chez les colleuses dont l’une pose les trois boutons et les galons en papier d’argent, l’autre le ceinturon et la plaque, tandis qu’une troisième ajuste la main gauche en carton après la manche qui est flottante sans bras. Cent automates à l’heure sont terminés par les colleuses et livrés au dernier essayage des vérificateurs. Définitivement accepté, poinçonné, le sergent de ville peut prendre enfin possession de la boîte bleue et rouge, aux couleurs de la ville de Paris, qui lui sert de guérite.Extrait de :
Pierre Calmettes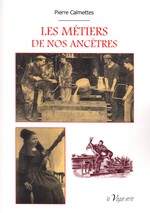 LES MÉTIERS DE NOS ANCÊTRES 15 x 21 cm - 306 pages - près de 200 dessins de l'auteur
LES MÉTIERS DE NOS ANCÊTRES 15 x 21 cm - 306 pages - près de 200 dessins de l'auteur
Pour en savoir plus sur ce livre... votre commentaire
votre commentaire
-
Par éditionslavagueverte le 18 Décembre 2023 à 07:00

Le 17 août 1560, un règlement d’ensemble nous donne la physionomie du marché au XVIe siècle. Les marchands, qu’ils soient de la ville ou forains, sont tenus de conduire leurs marchandises aux lieux et places ci-après déclarés pour exposer en vente si bon leur semble.
Les bois, charbons et fourrages, sur la place Saint-Pierre et non ailleurs, à peine de 10 sols d’amende, de confiscation des marchandises et de punition de prison. Un tiers de l’amende sera donné à l’accusateur. Les marchandises ne doivent pas arriver avant midi.
Les bonnetiers, lingers, cordonniers, viesiers (fripiers), sueurs de vieil étalent à l’entour de la place du Pilori, jusqu’à la porte Comtesse.
Les quincaillers étalent le long de la muraille du logis d’Ezechias Darrest, tirant vers les Halles, sans empêcher la petite rue tournant vers la rivière (Petit-Marché).
Les œufs, beurre, fromages se vendent au Béguinage, devant le couvent des Sœurs de Saint-François (ancienne place Lefébure de Cerisy ou Placette). Les chapons, pigeons, oies, poules, canards et autres volailles se vendront au Grand Marché, depuis l’enseigne du Bar (côté Est de la place) jusqu’à la veille maison Sueur. Les fruitiers étalent et vendent tous les jours de la semaine devant l’église Saint-Vulfran depuis le chemin des Halles jusqu’à la maison Barbafust.
Les tartes, pâtés, norolles (espèce de petite brioche) venant du dehors, se vendent au Grand Marché autour de la croix, assez loin des étaux des boulangers de la ville.
Les poireaux, aulx, oignons, etc. se vendent depuis la porte de derrière de l’Hôtel-Dieu, le long de la muraille, jusqu’à l’huis du cimetière Saint-Vulfran.
Les revendeurs d’œufs, beurre, fromages et volailles ne peuvent acheter ces denrées aux paysans avant 10 heures, ni avant qu’ils les aient exposées en vente à peine de 60 sols d’amende, dont le tiers à l’accusateur. Les blattiers et meuniers ne peuvent acheter des blés avant midi, sous peine de punition corporelle,
60 sols d’mande et confiscation desdits blés. [...]
En 1602, le marché au beurre fut transféré devant Saint-Vulfran, pour dégager la porte de l’Hostel-Dieu, tandis que l’échevinage transfère le marché aux chevaux de la Porte Saint-Gilles à la place Saint-Pierre où sont les hôtelleries et donc plus commode. Celle-ci accueillera un demi-siècle plus tard le marché aux chanvres et aux lins tenus tous les jours de franc-marché et tous les jeudis en la rue des Jeux de Paulme et de l’Arquet. [...]
Tout le centre de la ville paraît avoir été envahi par les grands marchés, en particulier, les abords du Marché au blé et du pont aux Brouettes. On imagine les encombrements dans ce dédale de rues et de ruelles bien qu’il fût enjoint aux marchands de faire leur étalage de manière que les habitants fussent point gênés pour circuler.Micheline Agache
(avec l’autorisation de R. Agache)Extrait de :
 LA PICARDIE : Récits historiques
LA PICARDIE : Récits historiquesVolume 1
Collectif
15.8 x 24 cm - 186 pages - Illustrations, cartes postales anciennes, plans...
Pour en savoir plus sur ce livre... votre commentaire
votre commentaire
-
Par éditionslavagueverte le 14 Décembre 2023 à 11:24

Entrons donc dans un passage qui s’ouvre à gauche du théâtre, nous y trouverons haute encore une tour en briques ; c’est tout ce qui subsiste de l’ancien château connu sous le nom de Logis du Roi. Cette tour fut le donjon de l’habitation ; c’est de son sommet que le comte de Saint-Pol aperçut, au mois de décembre 1593, les troupes espagnoles qui venaient surprendre la ville.
Cette tour est faite de deux constructions de forme hexagonale appliquées l’une contre l’autre ; la plus importante renferme un escalier en vis de Saint-Gilles.
Au-dessus de la porte décorée de feuillages, de niches et de clochetons, on voit encore les anges qui soutenaient jadis l’écusson royal.
En 1517, racontent les anciens historiens de la ville, François Ier, charmé de la réception qui lui avait été faite par les Amiénois, résolut de passer désormais une partie de l’année au milieu d’eux. En conséquence, il fit construire, sur l’emplacement de l’hôtel des Trois-Cailloux, l’édifice dont nous parlons.
C’était, dit le docteur Goze, un château en pierre et brique très richement décoré à l’intérieur et entouré d’un mur crénelé flanqué de tourelles et plongeant dans un fossé que traversait un pont-levis. Après la bataille de Pavie, le logis fut abandonné par son royal hôte et devint l’habitation des gouverneurs de la province. Mais jusqu’au milieu du dix-septième siècle, époque où il tomba en ruine, il servit de logis à tous les grands personnages dont Amiens reçut la visite. Marie de Lorraine, veuve de Jacques V, y séjourna lorsqu’elle vint en France implorer le secours du roi Henri II ; Antoine de Bourbon, père de Henri IV, le prince de Condé, le duc de Nevers, le duc de Longueville l’habitèrent en 1551, 1505, 1587 et 1588.
Pour la famille de ce dernier, le château se transforma en prison pendant les troubles de la Ligue, depuis la Noël de 1588 jusqu’au 2 janvier 1593. Là passèrent ensemble, en 1625, Marie de Médicis, Anne d’Autriche et Henriette de France, nouvellement mariée à Charles Ier d’Angleterre. Là habitèrent encore Louis XIII et Louis XIV, le premier en 1640, lorsqu’il pressait les opérations du siège d’Arras, le second en 1647, donnant par sa présence un grand éclat aux cérémonies de la Fête-Dieu.
Dans ce qu’il resta du logis morcelé, la salle des concerts dits d’Apollon s’établit en 1748 ; sous la Révolution, elle devint le siège d’un club et disparut en 1798.
Aujourd’hui, la tour sert d’enseigne à un concert et l’ancien nom du château est devenu celui d’un établissement
de bains.Extrait de :

UNE VISITE À AMIENS EN 1896
Alexis Martin
21 x 15 cm - 128 pages - nombreuses illustrations et cartes postales anciennes votre commentaire
votre commentaire
-
Par éditionslavagueverte le 7 Décembre 2023 à 08:00

Philippe de Valois arrive au château de Labroye.
Le courage dont Philippe de Valois fit preuve dans la funeste journée de Crécy et la valeur de la chevalerie de France méritaient un meilleur destin.
Lorsque la victoire se fut déclarée pour les Anglais et pendant que le vieux roi de Bohême, fidèle allié de la France, s’était jeté dans la mêlée avec la principale noblesse du royaume, pour rallier les fuyards ou mourir, Philippe de Valois, désespéré, résolut de ne pas survivre à sa défaite. On le vit ramener au combat les chevaliers de son escorte et se précipiter à leur tête dans les rangs ennemis. Jacques de Bourbon et le sire d’Aubigny, voyant sa perte certaine, saisirent les rênes de son cheval et l’entraînèrent, malgré sa résistance, loin du champ de bataille. La nuit était venue, et la plaine retentissait encore des clameurs victorieuses de l’armée anglaise auxquelles venaient se mêler les cris de douleur des soldats de Philippe dont les corps avaient comblé les fossés et couvraient les chemins voisins des champs de Crécy. Le roi s’éloigna enfin de cette sanglante scène et prit son chemin vers l’Authie, suivi de messire Jean de Hainaut, des sires de Montmorency, de Beaujeu, d’Aubigny, de Montsault et d’environ soixante chevaliers. « Il faisoit, dit Froissart, moult brun et moult épais » lorsque Philippe de Vallois arriva sous les murs du château de Labroye.
Les portes de ce manoir étaient fermées ; on tenait le pont-levis aisé, et les hommes d’armes veillaient aux meurtrières, car les premiers fuyards avaient déjà raconté les malheurs de la journée et tout indiquait que les Anglais ne tarderaient pas à se répandre dans le pays. Les chevaliers de la suite du roi demandèrent à entrer ; le châtelain, Robert de Grandcamp, parut sur les créneaux et leur dit : « Hommes d’armes, qui êtes-vous ? Si vous ne servez monseigneur de Valois, vous n’entrerez oncques dans mon chastel. » Le roi ému s’écria alors : « Ouvrez, ouvrez, châtelain ! c’est l’infortuné roi de France ! » Robert de Grandcamp, reconnaissant la voix de Philippe, ordonna l’ordre aussitôt de faire baisser le pont-levis, d’ouvrir les portes et alla recevoir le roi. On dit que le châtelain ne put vaincre l’excès de sa douleur à l’aspect de son malheureux maître et que le prince dut oublier ses maux pour consoler ce serviteur fidèle.
« Le roi, dit Froissart, et toute sa route (troupe) furent là jusques à mie nuit. Si but un coup et aussi firent ceux qui avec lui étoient, et puis s’en partirent et issirent du châtel, montèrent à cheval et prirent guides pour eux mener qui connoissoient le pays. Si entrèrent à chemin environ mie nuit et chevauchèrent tant que, au point du jour, ils entrèrent dans la bonne ville de Amiens. Là s’arrêta le roi et se logea en une abbaye et dit qu’il n’iroit plus avant tant qu’il sut la vérité de ses gens, lesquels estoient demeurés et lesquels estoient échappés. »
P. Roger
Extrait de :
 HISTOIRE AU PAYS DE SOMME CollectifVolume 1 : depuis l'époque romaine jusqu'en 190015.8 x 24 cm - 176 pages - Illustrations, cartes postales anciennes, plans...
HISTOIRE AU PAYS DE SOMME CollectifVolume 1 : depuis l'époque romaine jusqu'en 190015.8 x 24 cm - 176 pages - Illustrations, cartes postales anciennes, plans...
Pour en savoir plus sur ce livre... votre commentaire
votre commentaire
-
Par éditionslavagueverte le 30 Novembre 2023 à 08:00

Folleville, les ruines du château et sa tour de guet, et l’Eglise.
Nous avons ici les restes d’un bâtiment qui fut habité pendant cinq siècles, en période de paix comme dans les temps de violence. Il est difficile d’imaginer aujourd’hui la forteresse-refuge, qui fut en même temps le centre de vie journalière d’une classe dominante où l’on trouve toutes les pièces nécessaires au confort quotidien des habitants.
La grande salle :
La cheminée encore en place dans le mur et probablement aussi celle de la cuisine ont rempli leur fonction fréquente de séchoir.
Initialement, la grande salle était destinée à rendre la justice, à recevoir les hommages. Pour les banquets la table des repas était dressée sur des tréteaux, avec le haut bout du côté de la cheminée où était la place du maître (dos au feu, ventre à table) et le bas bout situé du côté des pièces de service.
La cuisine :
Dans l’angle du mur un arrondi de pierres et de briques : ce qui reste du four.
La cheminée ou ce qu’il en reste. Sa largeur intérieure devait permettre de faire tourner à la broche des pièces importantes. On remarque qu’un départ de l’escalier de la cave s’ouvre dans cette salle. L’accès à cet escalier s’ouvrait par une trappe horizontale.
La tour sud-est :
Au rez-de-chaussée, c’est la carbonnière, réserve de bois et de charbon de bois qu’une porte extérieure servait à approvisionner. A l’entrée à droite de la carbonnière, se voient encore les trois premières marche d’un escalier à vis étroit qui fut construit dans l’épaisseur du mur de la tour (les murs du château ont d’épaisseur 1 m 60). Et on observe dans ce même mur une sorte de cheminée, conduit vertical, qui descend en direction du collecteur, lequel conduit les eaux usées dans le talus côté sud.
L’étuve :
Au premier étage (ou la salle-de-bain). On sait que l’habitude de prendre des bains était répandue, à la fin du XVe siècle du moins dans les familles milles nobles.
La chambre du roi :
Au premier étage. Située au dessus de la cuisine, elle bénéficie ainsi en hiver de la chaleur ainsi dégagée et attenant à l’étuve dont nous avons parlé.
D’après les inventaires, cette pièce est appelée au XVIe siècle « la chambre du roy ». C’est dons là qu’a dormi François Ier en sept 1544, et vraisemblablement ses prédécesseurs, Louis XI en 1477, Charles VIII et sa femme Anne de Bretagne en 1492, Louis XII sans parler de Charles le Téméraire.
La chambre du curé et la tour sud-est :
Saint Vincent de Paul y séjourna environ 18 mois.
La chambre du sommelier et la tour nord-ouest :
La pièce située à la base de cette tour s’appelle « la sommellerye » en 1571. Il est vraisemblable qu’elle avait perdu sa fonction initiale, celle où résidait le sommelier, avec sa vaisselle, son vin, son linge. De là, à proximité du maître de maison, assis à table, dos tourné à la cheminée, il pouvait transmettre les ordres à un caviste ou garçon de cuisine pour tirer le vin au tonneau pendant les repas de fête. Apparemment, il n’y a plus à la fin du XVIe siècle de sommelier attitré en ce lieu.
Les latrines (toilettes) :
De l’intérieur des murailles de ce château, on observe au premier comme au second étage la porte d’accès à la pièce ronde dans la tour. Juste à côté le couloir d’accès aux latrines est encore visible. Ce couloir était fermé par
une porte, et indépendant de la chambre voisine. Ces latrines, on les désigne dans les textes du XVIe siècle « les retraits » et par la suite « les privetz ». A Folleville, elles étaient agencées dans le fond du mur en arrondi avec un siège formé d’une planche trouée.
La tour de guet ou la guette :
Cette tour construite à la fin du XVe siècle sous Raoul de Lannoy, parvenue seule entière, présente une forme originale : elle est cylindrique à la base et puis hexagonale et enfin au sommet dodécagonale. Elle servait également d’accès au différents étages du château grâce à son escalier en vis.
La façade du château :
Au rez-de-chaussée de la façade et à l’étage dans la tour, 2 fentes verticales sont des archères destinées au tir d’armes à cordes. Elles avaient aussi une fonction de dissuasion : de l’extérieur le guetteur éventuel était visible.
_____________
Le comte de Mailly, dernier seigneur et maître du château, devenu propriétaire des lieux par son mariage avec Marie-Michèle de Séricourt en 1737 a provoqué la destruction de cette vieille forteresse. Les fossés rendaient cher et compliqué tout projet d’extension de ce vieux château féodale aux murs épais. C’est en 1777 que commence la démolition du château transformé en carrière de pierres, de bois et de plomb. La comtesse de Mailly s’accrochait au château qui était celui de sa famille depuis plus d’un siècle et demi. Elle y logeait encore alors que la démolition avait commencé.
Association “Site de Folleville”+ d'infos sur l'histoire de Folleville :
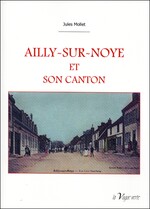 AILLY-SUR-NOYE ET SON CANTON
AILLY-SUR-NOYE ET SON CANTON
Jules Mollet
15 x 21 cm - 132 pages - avec cartes postales anciennes
 votre commentaire
votre commentaire




